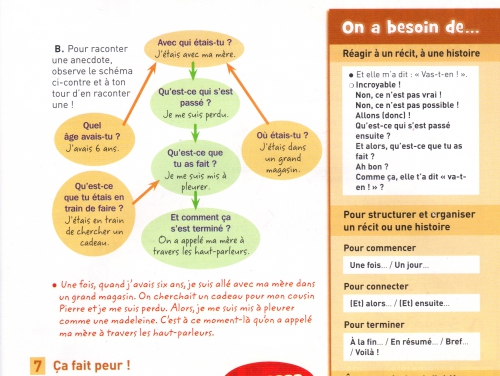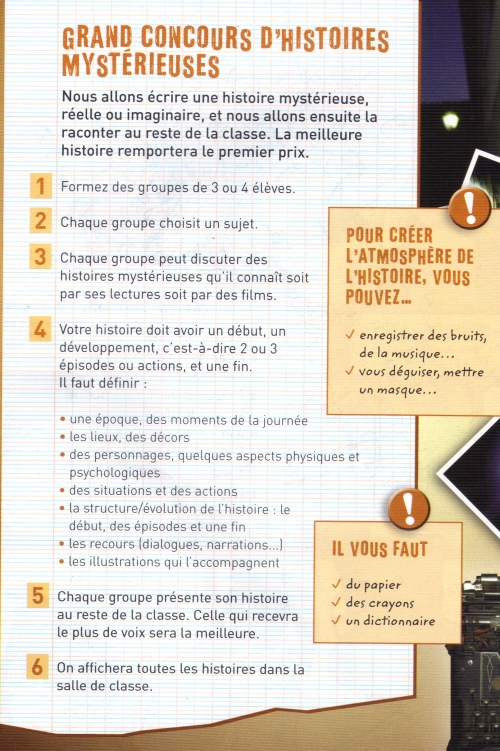production écrite: écrire un texte narratif
www.youtube.com/watch?v=vCeWcHVcL4s
si le lien ne fonctionne pas juste copiez l'adresse dans votre navigateur et ajouter deux points (:) après http
donc le lien doit être comme le suivant
fiche méthodologique : les jeux de rôles en classe
Fiche méthodologique
Prépare un jeu de rôles
Exemple : ACHETER/VENDRE UNE VOITURE
Niveau : tronc commun / 1ere Bac / 2eme Bac
Thème : les voitures
Activité proposée :
Jeu de rôles : Vous voulez vendre votre voiture, vous avez mis une annonce dans le journal. Des acheteurs potentiels vous téléphonent.
- Le professeur présente les règles, modalités du jeu de rôles : phase de préparation, phase de réalisation, phase d’évaluation.
- La classe est divisée en sous-groupes.
- Le professeur distribue les fiches de rôle et les documents associés au jeu de rôle pour chaque sous-groupe (s’il en a prévu).
Comment traiter le thème ?
Modalité 1 : chaque sous-groupe jouera la même scène à tour de rôle.
Modalité 2 : Chaque groupe joue des scènes sur le même thème mais les situations sont toutes différentes.
Après quelques séances de jeux de rôles, les consignes de préparation doivent devenir des automatismes. Au cours des premières séances, le professeur doit les rappeler, si nécessaire. Ensuite, elles doivent être appliquées sans intervention du professeur.
Modalité 1 : les élèves écrivent un dialogue qu’ils lisent ensuite. Dans cette hypothèse, les élèves doivent avoir été entraînés à oraliser leur production écrite, c’est-à-dire lire le dialogue avec suffisamment d’expressivité pour que cela ne soit pas ennuyeux pour l’auditoire.
Avantage : cette méthode permet aux élèves de réemployer de façon plus complète connaissances et compétences.
Inconvénient : ce n’est pas « vraiment » de l’expression orale.
Modalité 2 : les élèves se mettent d’accord sur un scénario, prennent des notes sur son déroulement, font une « répétition »
Avantage : cette méthode est « vraiment » de l’expression orale. Il s’agit d’une semi-improvisation.
Inconvénient : le contenu de la production risque d’être appauvri dans la mesure où il s’agit d’improviser à partir de notes.
Conseil : pratiquer la modalité 1 au début puis passer progressivement à la modalité 2 en expliquant aux élèves pourquoi on change de procédure et en les prévenant que c’est normal, si on utilise la modalité 2, de produire une performance moins riche.
Préparer à partir de quoi ?
Cas 1 : L’enseignant considère que les apprenants possèdent tous les outils
nécessaires à la réalisation du jeu de rôles ;
Cas 2 : Il est nécessaire de leur fournir des fiches récapitulatives (lexique, actes de parole, points de grammaire) ou de mettre en place, après avoir formulé les consignes, un remue-méninges collectif.
Important ! Il faut que les élèves apprennent à travail rapidement. A ce titre, leur indiquer un temps de préparation limité et exiger qu’ils le respectent.
Conseils aux professeurs pour les phases de réalisation et d’évaluation :
1. Pendant la préparation :
Le professeur se tient à la disposition des groupes s’ils ont besoin d’une aide ponctuelle.
2. Pendant la réalisation :
- L’enseignant n’intervient pas pour corriger les apprenants pendant leur prestation (sauf s’il s’aperçoit d’un problème grave d’intercompréhension : par exemple, il est visible que l’un des interlocuteurs n’a pas compris les intentions/propos/attitudes de l’autre. Dans cette situation une intervention est nécessaire pour éviter que le jeu de rôles se termine dans la confusion, le malentendu, ou en queue de poisson.
- Les autres groupes doivent être attentifs à la production. Pour y parvenir, le professeur doit leur donner des tâches à accomplir par rapport à la production : prendre des notes sur « l’histoire » pour les résumer ensuite, noter le vocabulaire spécifique du thème, noter la construction des verbes employés, etc.
- Pendant la production, l’enseignant prend des notes qu’il utilisera dans la phase d’évaluation.
- L’évaluation doit se faire en deux temps :
• Evaluer la production sous un angle communicatif : L’objectif recherché a-t-il été atteint ou pas ?
• Evaluer la production sous un angle linguistique : noter les fautes les plus marquantes, les expliquer à la classe, éventuellement proposer des exercices de remédiation.
comment exploiter une chanson en classe
FICHE PÉDAGOGIQUE
GRILLE D’ANALYSE D’UNE CHANSON
(Illustration : J’ai besoin d’amour)
I. COMPRÉHENSION ORALE
- Introduction – Présentation de la chanson (titre, interprète)
- 1ère audition (sans texte) : impressions générales, compréhension globale : le thème. l’histoire, le type de sentiments exprimés, etc.
Exemple : Cochez la bonne case :
Le thème dominant de la chanson est
◊ l’amour ◊ la haine ◊ le regret ◊ la souffrance
- Description et analyse : 2e écoute (avec le texte).
- les paroles : recherchez les mots-clés
Exemple : Voici une liste de mots. Entourez les mots que vous entendez dans la chanson :
◊ love ◊ heureuse ◊ bisous
◊ toujours ◊ bras ◊ embrasser
- la musique : forme vocale (strophes ou couplet-refrain).
II. COMPRÉHENSION ÉCRITE
1. Analyser le vocabulaire :
a. Faire la différence entre famille de mots et champ lexical
Exemple :
Famille du mot « amour » : aimer, amoureux, amant, etc.
Champ sémantique du mot « amour » : baisers, câlins, cœur, bisous, caresses, etc.
b. Travail sur la synonymie / l’antonymie.
Exemple :
Donnez des synonymes de : querelle, instant, etc ;
Donnez les antonymes de : mauvais, oublier, aimer, jamais, etc.
c. Repérage des temps verbaux
Exemple : présent de l’indicatif ; futur simple
d. Repérage des adverbes
Exemples :
Adverbes d’affirmation : bien sûr
Adverbes de négation : ne, jamais
Adverbes de manière : vraiment, comme
Adverbes de temps : toujours, de temps en temps
Adverbes de lieu : par-ci par-là
- 4. Interprétation de la chanson
● Quel est le message ? (critique, dénonciation, émotion, amour, etc.)
● Quelle impression vous a laissé la chanson ?
Pour aller plus loin
III. EXPRESSION ORALE
● Jeu de rôle : Vous êtes amoureux(-euse) d’un copain /une copine de classe ; un jour, vous osez lui parler et vous voulez lui faire une déclaration d’amour. Jouez la scène.
● Exprimez le contenu de la chanson en un paragraphe, une phrase, un mot, un symbole.
III. EXPRESSION ÉCRITE
● Imaginer et décrire le lieu idéal pour la première déclaration d’amour.
● Faire le portrait physique et moral de l’homme / de la femme idéal(e) accompagné d’un portrait.
● Créer des mots croisés.
Exemple :
Complétez la grille avec le mot qui manque.
1. Mon premier ……………… ? Je m’en souviens comme si c’était hier.
2. Il est ……………………… fou de Florence.
3. Je t’envoie de gros ………………. ! Signé : Casimir
4. – Mlle Irène Potin, voulez-vous prendre pour époux M. Guy Pol, ici présent ? - ………
5. On en fait aussi aux animaux domestiques.
|
|
|
B |
A |
I |
S |
E |
R |
|
|
|
|
|
A |
M |
O |
U |
R |
E |
U |
X |
|
B |
I |
S |
O |
U |
S |
|
|
|
|
|
|
|
O |
U |
I |
|
|
|
|
|
|
|
C |
A |
R |
E |
S |
S |
E |
S |
|
● Relire plusieurs fois les paroles. Écouter la chanson. Imaginer le scénario d’un clip pour la chanson : couleurs utilisées, paysages, images, personnages et lieux possibles. Utiliser le futur.
● Composer une strophe supplémentaire.
● Écrire une nouvelle chanson sur le même thème.
Lorie - J’ai besoin d’amour
Moi, J’Ai Besoin D’Amour
Des bisous, des câlins
J’en veux tous les jours
J’suis comme ça.
Mon coeur est à la fête
Lorsque tu me prends dans tes bras
Ça me suffit, je suis heureuse comme ça
Un petit signe de la tête
Des p’tits clins d’oeil par ci et par là
Ça prouve que tu penses à moi.
Les belles romances, n’ont de sens que lorsque l’on est amoureux
J’ai envie de le lire dans tes yeux.
[Refrain] :
Moi, J’Ai Besoin D’Amour
Des bisous, des câlins
J’en veux tous les jours
J’suis comme ça
Quand J’Ai Besoin D’Amour.
Tous les moments « love »
Moi, je suis vraiment pour
J’suis comme ça
Au fond de moi.
Tu vois, c’est pas la peine
De m’ chanter un air d’opéra
Un p’tit « texto » qui dit je t’aime
Et ça me va
Si je te fais des scènes
J’espère que tu comprendras
Que je pense toujours à toi.
Les belles romances, n’ont de sens que lorsque l’on est amoureux
J’ai envie de le voir dans tes yeux [Refrain]
Mais de temps en temps
Bien sûr on a des querelles
Mauvais temps avant le soleil
Mais ne jamais
Oublier juste un instant de dire : je t’aime
À ceux qu’on aime, vraiment. [Refrain]
faire des jeux de rôles en classe
Fiche méthodologique
Faire un jeu de rôles
Niveau : 1ere Bac / 2eme bac
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se pratique par petits groupes de 2 à 4 personnes.
Chaque groupe a le même jeu de rôles ou des jeux de rôles différents.
1. Préparation
a. Proposer le jeu de rôles
- Formuler la consigne clairement
- Préciser le temps de préparation
- Constituer les groupes
- Chaque groupe se répartit les rôles
NB. : L’enseignant peut fournir un canevas, donner des consignes moins précises
quant au déroulement, se contenter de « lancer le jeu ».
b. Consignes de préparation :
- ne pas écrire un dialogue qui sera ensuite lu
- prendre des notes qui permettront de faire une semi-improvisation
- structurer la production : celle-ci a un début, des étapes successives, une
conclusion. Elle ne se termine pas « en queue de poisson ».
NB. : Les consignes de préparation doivent devenir des automatismes.
L’enseignant, après quelques séances, se contente de les rappeler, si nécessaire.
Aide aux apprenants :
- L’enseignant peut considérer que les apprenants possèdent tous les outils
nécessaires à la réalisation du jeu de rôles ou au contraire leur fournir des fiches
récapitulatives (lexique, actes de parole, points de grammaire) ou mettre en place,
après avoir formulé les consignes, un remue-méninges collectif.
- Il se tient à la disposition des groupes s’ils ont besoin d’aide ponctuelle.
2. Réalisation
a. Mise en oeuvre pratique
Variante 1 : Les apprenants restent assis à leur place pour présenter leur
production
Variante 2 : Les apprenants théâtralisent leur production : ils la jouent debout
avec gestes et mimiques.
b. Présentation des productions
- Elles se font l’une après l’autre.
- L’enseignant n’intervient pas pour corriger les apprenants pendant leur prestation
- les autres groupes sont attentifs à la production
NB. : Pour favoriser l’attention des « spectateurs », l’enseignant peut leur fournir
des tâches pendant la production : prendre des notes pour faire un résumé, vérifier
si l’objectif du jeu de rôle est atteint, etc.
3. Evaluation de la production
Elle s’effectue sur la base de critères connus des apprenants.
a. Pertinence actionnelle
- Respect de la consigne
- Objectif atteint ou non
- Cohérence de la production
b. Pertinence lexicale
L’enseignant a pris note des erreurs dans les choix lexicaux et il explicite ces
erreurs.
c. Pertinence grammaticale
L’enseignant a noté les fautes commises et il en explicite certaines.
d. Pertinence culturelle
L’enseignant a identifié des écarts par rapport à la culture cible et il les
explicite (tout en les relativisant)
Remarques :
- Si les élèves sont débutants (dans la pratique du français et/ou celle du jeu de
rôles), ralentir le rythme afin de mettre la technique en place
- Utiliser toujours la même procédure afin de créer des automatismes (acquérir des
savoir-faire et des savoir-apprendre)
- Se montrer exigeant quant au respect des règles du jeu : ne pas écrire des
phrases entières, construire le jeu de rôles de façon rigoureuse, ne pas s'arrêter an
cours de route, écouter les autres.
comment préparer une fiche pédagogique pour une activité ( lecture/langue/activités orales/production écrite)
Production écrite
Phase1
- Annoncer le thème de la production
- Noter le sujet au tableau
- Expliquer le sujet
Phase 2
- Elaborer un plan collectif
- Chercher les idées collectivement
- Laisser aux élèves le temps de rédiger leur texte
- Vérifier individuellement les textes produits
Phase 3
- Faire lire certains textes
- Produire un texte collectivement un texte au tableau à partir des participations des élèves
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Langue
Phase 1
- Lire le document de base
- Comprendre le document
- Donner aux élèves la consigne de relever l’élément linguistique à étudier
Phase 2
- Tracer un tableau et demander aux élèves de le compléter
- Mise en commun collective
- Observer le tableau et dégager la Règle
- Noter la règle au tableau
Phase3
- Exercices de réemploi oralement / par écrit
- Exercices à faire
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activités orales
Phase 1
- Mise en situation
- Annoncer le thème
- Faire un remue méninges sur le thème
- Faire écouter / lire le document déclencheur
- Répondre à des questions de compréhension
Phase 2
- Inciter les élèves à exprimer leur point de vue
- Ou / jouer la même scène
- Ou à produire oralement
Phase 3
- Faire un bilan collectif
- Annoncer la production écrite
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecture
Phase 1
- Faire une mise en situation
- Faire le compte rendu oral des chapitres lus
- Donner aux élèves les consignes de ce qu’il faut relever du texte
- Leur demander de lire silencieusement le texte
Phase 2
- Identifier le texte
- Situer le texte
- Identifier le lieu / le temps de l’action
- Le type de texte
- Le narrateur
- La focalisation
- Le thème
- Annoncer les axes de lecture
- Inciter les élèves par des questions à relever les axes de lecture fixés pour la séance
Phase 3
- A partir des axes tirer une récapitulation collective
- Demander aux élèves d’exprimer leur opinion
l'analyse prépédagogique
|
L'ANALYSE PREPEDAGOGIQUE... Au plan de l’intervention didactique, la compréhension de l’écrit est un exercice décisif. Elle distingue généralement dans sa temporalité pratique même, le fond qu’il faut comprendre et interpréter convenablement et la forme qui l’ exprime . Dans les domaines de la lecture et de l’écriture, l’imprégnation par les textes ,est à la base de l’imitation dans les écrits. Une pédagogie de la compréhension de texte implique que l’apprenant sache interroger un texte et formuler des hypothèses afin de trouver dans le document qu’il consulte des réponses à ses questions, c’est-à-dire en fait les informations qu’il cherche. Mais si l’enseignant veut aider l’apprenant dans ses repérages et ses prévisions, il a besoin de savoir comment le texte « fonctionne » et quelles sont les données qui faciliteront éventuellement la formulation d’hypothèses, leur vérification et finalement, la compréhension de l’apprenant . Aussi faut-il qu’il ait analysé les textes au préalable, avant que le cours ne commence, c’est ce que l’on appelle l’analyse prépédagogique.
L’analyse prépédagogique des textes : (une étape dans le processus de scolarisation du savoir.)
Tout texte destiné à être utilisé dans un cours de langue nécessite une analyse préalable par l’enseignant. On l’appellera l’analyse prépédagogique, car elle concourt à la préparation de l’acte pédagogique et ne sert à la différence des analyses théoriques, ni à construire ni à tester une théorie linguistique . Dans le domaine particulier de la compréhension de l’écrit, l’analyse prépédagogique a deux objectifs principaux : 1) d’une part, elle constitue, pour l’enseignant, un moyen d’investigation des fonctionnements d’un texte à différents niveaux (lors d’un cours il doit en effet pouvoir répondre aux demandes, pas toujours prévisibles, des apprenants) ; 2) d’autre part, elle doit permettre à l’enseignant d’imaginer les stratégies pédagogiques pour aider les apprenants à accéder au(x) sens d’un texte ( technique de repérage, découvertes d’indices, tactique de vérification. etc.). L’analyse prépédagogique consiste à poser sur le document plusieurs regards successifs afin de trouver l’angle d’attaque pédagogiquement le plus efficace pour entrer dans le texte. Elle doit donc tenir compte des particularités de chaque groupe d’apprenants, de leurs motivations et de leurs besoins. Une démarche d’investigation textuelle : (Retour au sommaire) Il est nécessaire de montrer aux débutants en langue que l’on peut comprendre un texte sans forcément être capable d’en saisir chaque détail et de traduire chacun de ses termes, il faut leur faire prendre conscience de stratégie de compréhension qu’ils développent en langue maternelle (même si , en langue arabe, l’approche des textes y est encore impressionniste). L’approche globale des textes consiste à briser la linéarité du discours pour amener, dans un premier temps, les apprenants à trouver des indices textuels leur permettant d’une part de faire des prévisions sur l’architecture du texte et de formuler des hypothèses sur son sens, d’autre part de vérifier dans le texte lui-même ces mêmes hypothèses de prévision. Cependant, il est certain que plus les textes supports sont long, plus les indices textuels nécessaires à la découverte du sens et de la logique du discours seront disséminés entremêlés, voire enchevêtrés sur l’aire du texte. (Il est alors conseillé , en début d’apprentissage, pour initier vos élèves à cette approche sémiotique des textes, de leur proposer des supports courts où la typographie, l’illustration, la mise en page jouent un rôle prépondérant : annonce publicitaire, prospectus, tracts, textes de presses illustrés etc. Initier aux pratiques de repérage : Si l’on donne à un lecteur étranger ( c’est le cas de nos élèves en classe de français) un texte qu’il n’a pas choisi, un premier regard sur le texte lui fournit déjà quelques indications : la forme du document ( données iconiques), le contenu des titres (données thématiques), le type de support, et le nom du scripteur , s’il le connaît, l’amènent à anticiper sur l’organisation et le contenu de l’énoncé. Il s’agit alors de lui faire rechercher lors de balayages successifs du document, d’autres indices d’ordre formel, thématique ou énonciatif afin qu’il vérifie ses premières hypothèses et qu’il en formule de plus précises, reconstruisant ainsi peu à peu la logique et le(s) sens du texte. Repérages des indices formels : On entend par indices formels aussi bien les données purement iconiques ( typographie,alinéas,schémas,…) que les modèles syntaxico-sémantiques rendant compte de l’architecture du texte (articulateurs logiques, éléments anaphoriques…) 1) L’image du texte : Le texte est une image, comme on peut s’en rendre compte en examinant le comportement des enfants qui ne savent pas encore lire et feuillettent un livre illustré où le texte leur apparaît comme une image parmi d’autres, une image à déchiffrer à la lueur du contexte iconique. Dans les cours de langues étrangères, on s’appuie de plus en plus sur « l’image du texte » pour approcher le sens d’un document et le faire appréhender par les apprenants. Le sens est d’emblée donné (en partie du moins) par la typologie, l’illustration, la mise en page et les indices périphériques (titre, sous-titres, chapeau, références de différentes natures…) ; ces aspects sont prépondérants dans certains textes conseillés en début d’apprentissage, tels que les tracts, les prospectus, les annonces publicitaires ou les textes de presse illustrés. Cette lecture, qui part de repères iconiques pour orienter ensuite les stratégies de découverte du sens, vise à donner à l’élève des habitudes de lecture sélective en langue étrangère. 2) Approche linguistique : - Marques formelles d’énonciation : - Sujets énonciateurs, - Émetteurs, - Récepteurs, - Lieu d’énonciation, - Moment d’énonciation. - Modalités , - Modalités logiques, - Modalités appréciatives. - Actes de parole. 3) Approche logico-syntaxique . - repérage des relations temporelles, - repérage des substituts et procédés diaphoriques : déterminants, pronoms, anaphores, substituts lexicaux, répétitions, synonymes, … - repérage des formes de phrases. Ces trois approches constituent une grille d’analyse. Cette grille est forcément imparfaite, mais elle est perfectible,. Chaque enseignant doit établir sa propre grille, compte tenu de ce qu’il veut faire( son objectif), compte tenu de ses apprenants (leurs besoins) et des textes eux-mêmes.
Conclusion : Si l’on reste persuadé des avantages et de l’intérêt prépédagogique, elle n’en présente pas moins certains dangers : Le premier danger serait de la confondre avec les analyses théoriques du discours. Le cours de langue ne doit pas devenir un champ d’application pour des théories. L’analyse effectuée par l’enseignant de langue devrait l’être en fonction d’objectifs didactiques précis (mise en place d’un programme, d’une progression, mise au point de stratégies d’enseignement. etc.) ( Cela ne doit pas empêcher bien entendu l’enseignant de connaître différentes théories et de s’en inspirer.) Un deuxième danger, serait d’imposer aux apprenants une terminologie et de les « noyer » sous des termes spécialisés sous prétexte de leur faire repérer et classes les indices et des éléments linguistiques. Il n’est pas nécessaire de leur parler, comme c’est souvent le cas, de modalités, d’anaphores, de thèmes, de rhèmes, d’illocutions : on peut s’exprimer très simplement sur des exemples pris dans les textes mêmes. (c’est-à-dire se mettre à la portée de l’élève, ce qui ne signifie pas se mettre à son niveau ou, en d’autres termes, « baisser le niveau ». Il s’agit plutôt d’adapter le discours pédagogique aux références des apprenants.) Le risque est encore plus grand de mélanger les terminologies. Un autre danger serait de confondre l’analyse prépédagogique et les stratégies d’enseignement : il n’est pas question de refaire devant les apprenants l’analyse du texte que l’on aurait faite la veille et de retomber aussi dans les travers de l’explication de texte. La démarche non directive, suppose que l’on puisse répondre aux demandes très diverses des apprenants en langue quand ils cherchent à comprendre et interdit de leur imposer des stratégies de compréhension qui se heurteraient violemment à leurs propres stratégies d’apprentissages, mais le rôle de l’enseignant reste cependant de leur en proposer… Et c’est souvent l’analyse prépédagogique qui lui permet d’en trouver.
Sophie MOIRAND. In. Situation d’écrit. Edition Hachette. Paris 1979. Pp.74/88
P.S. « La notion de scolarisation du savoir renvoie à l’ensemble de la question du passage des savoirs de référence aux savoirs scolaires. La didactique s’intéresse à cette opération qu’elle pense en termes d’application, de transposition ou d’implication didactique. Toute pratique d’enseignement d’un objet présuppose la transformation préalable de son objet en objet d’enseignement. La transmissibilité scolaire pose les conditions de l’enseignabilité des supports. La participation de l’enseignant dans cette opération, est déterminante. En effet, il est fréquent qu’un professeur propose des textes à ses élèves , mais pas avant d’apporter la transformation adaptative nécessaire à ces documents c’est-à-dire rendre apte un savoir (un texte, une théorie…) à prendre place parmi les objets d’enseignement. » In. La didactique du français. J.F.HALTE. Ed. P.U.F Coll. Que sais-je ? Paris 1992 P.46. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Le Compte Rendu d'Expression Ecrite « Il ne sert à rien d’évaluer si ce n’est pour permettre à l’apprenant un retour éclairé sur son texte : apprendre à écrire, c’est sans doute apprendre à réécrire » Martine MARQUILLO. Le compte-rendu de rédaction est la dernière étape d’un apprentissage inscrit dans le cadre d’une Unité Didactique. Ainsi c’est à travers la correction de copies d’élèves que l’enseignant va observer le degré de réinvestissement par les apprenants du modèle d’expression et les notions morphosyntaxiques qu’il avait auparavant dispensés tout le long de l’U.D. Le Compte-Rendu dans l’U.D. (une séquence pédagogique). |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Le compte rendu est donc un moment important de remédier aux difficultés rencontrées par les élèves dans leur textualisation (production écrite). La séance du compte-rendu va fonctionner par rapport aux apprenants, en premier lieu, comme un moment-miroir qui devrait les inviter à réfléchir sur le pourquoi de chacune de leurs erreurs et en second lieu, les contraindre à mette en œuvre une stratégie pour gérer ces erreurs afin de les corriger et de les dépasser. Le compte-rendu n’est pas seulement une aide à l’apprentissage, c’est aussi un objet de mesure et d’appréciation de l’évolution de la compétence des élèves à la fin de l’U.D avant d’entamer celle qui va suivre dans le cadre du projet didactique en cours de réalisation. Toutefois, cette séance ne peut être utile que si elle fait partie d’un enseignement/apprentissage s’appuyant sur la « pédagogie par objectifs ». En effet, les activités de réécriture qui seraient prévues dans la séance de compte-rendu ne peuvent être efficaces que si ces exercices relèvent de présupposés linguistiques et didactiques cohérents. Il est évidemment, peu aisé de connaître les compétences communicatives de ses élèves s’ils sont testés sur un contenu de type structural ou d’étude morpho-syntaxique. Ce qui nous emmène à poser le problème du lien entre objectif et évaluation. En effet, l’évaluation formative ne peut se concevoir aujourd’hui sans y associer la notion d’objectif d’apprentissage. Ces deux notions sont devenues totalement liées et incontournables : «Aucun processus d’évaluation n’a de sens indépendamment des objectifs d’apprentissage visés, réciproquement, l’objectif n’existe véritablement que s’il inclut dans sa description même ses modes d’évaluation. » Louis PORCHER. Par ailleurs, pour être pertinente, une évaluation doit être « valide c’est-à-dire qu’elle doit mesurer exactement et exclusivement ce qu’elle est censée mesurer » Il doit donc y avoir correspondance entre contenu du test, surtout au niveau de sa consigne et l’objectif de l’apprentissage. C’est vrai que ce n’est pas toujours facile à obtenir, mais lorsque l’on n’évalue que la maîtrise de l’objectif opérationnel bien conçu et bien construit, cette qualité s’obtient aisément. Il est à faire remarquer malheureusement que l’impact de la consigne de travail est fréquemment sous-estimé et on assiste par conséquent le plus souvent à des dérives et à des distorsions observées par la suite, dans des copies d’élèves, ayant pour origine des ambiguïtés dans la formulation des sujets de rédaction qui en outre n’explicitent que rarement les critères de réussite.
Conclusion : Se baser sur des objectifs opérationnels pour enseigner et évaluer n’est pas un but en soi, car cela ne suffit pas à faire progresser l’élève. C’est la séance de compte-rendu, en fin d’U.D, grâce, essentiellement, aux résultats analysés des travaux d’élèves, qui est importante puisque cette séance est le moment , dans l’U.D, qui va montrer à l’enseignant et aux apprenants si l’objectif annoncé au départ a été atteint ou pas. Ainsi ces résultats, dans une évaluation formative, aideront chacun, à l’intérieur du tandem enseignant/apprenant, à maîtriser son rôle. Le professeur, en faisant son diagnostic, ne pourra ignorer les lacunes et les points forts de l’élève et ce dernier saura à tout moment où il en est, sur quoi s’appuyer et l’étendu de l’effort qu’il lui reste à fournir. Pour l’un comme pour l’autre, cette séance, si elle est sérieusement intégrée à l’apprentissage va être un appui, une aide. Elle ne sera plus perçue comme une séance inutile, mais plutôt un outil nécessaire dont on se servira pour construire efficacement l’apprentissage guidé de l’écrit dans la durée en sachant vraiment où l’on va. Car en ce qui concerne l’enseignant, son rôle est effectivement d’emmener l’élève d’un état initial X à un étal final ou intermédiaire Y, à travers un cursus de formation préalablement déterminé dont le contenu et les objectifs devraient être communiqués aux apprenants puis discutés avec eux. Ainsi, les apprenants sont impliqués dans cette dynamique d’apprentissage dont ils sont la cible. C’est pourquoi le professeur doit se donner les moyens d’évaluation et de remédiation nécessaires et efficaces pour mener à bien sa mission. Le compte-rendu d’expression-écrite doit être perçu dans cette « nouvelle » vision . Il est par conséquent, nécessaire de remettre en question cette manière traditionnelle de corriger qui se limite généralement à des phénomènes de surface (orthographe, grammaire, vocabulaire…) ou à des remarques « verdictives » ( mal dit, maladroit, impropre, incorrect…) qui le plus souvent ne veulent rien dire pour nos élèves. Au contraire le compte-rendu de rédaction doit s’orienter vers la correction des dysfonctionnements de la composante textuelle et discursive dans les reproductions écrites de nos élèves. Aussi le professeur doit-il être capable de relever, dans les copies de ses élèves, ces erreurs textuelles, d’analyser leurs incidences et leurs portées afin de pouvoir prescrire une modification pour l’apprenant. P.S/ JUNG, le médecin et psychologue suisse (1895-1961) disait aux psychothérapeutes et demandons-nous si ce qu’il leur conseille n’est pas vrai aussi pour les enseignants, face aux erreurs des élèves dans la construction de leur savoir : « Ce qui est, réellement, c’est ce qui se montre actif. Si ce qui m’apparaît comme une erreur est en fin de compte plus efficace et plus puissant qu’une prétendue vérité, il importe d’abord de suivre cette erreur, car c’est en elle que gisent la force et la vie, que je laisserais échapper si je persévérais dans ce qui est réputé vrai. La lumière nécessite l’obscurité, sans laquelle elle ne saurait être lumière. » En effet, notre conception de l’erreur est à remettre en question. Ne faut-il pas faire de la dynamique de l’erreur un facteur d’intégration et non d’exclusion, par sa prise en compte, dans un premier temps, comme légitime et comme passage obligé ? Oui, laisser vivre les erreurs car toute erreur peut être créatrice et devenir la non-erreur -provisoire elle aussi- de demain ; mais ça ne sera possible que si notre enseignement est centré sur l’élève, sans bien entendu perdre de vue les références de l’école. Aussi une définition opérationnelle de l’erreur dans tout enseignement/apprentissage s’impose-t-elle et ce en réfléchissant à une stratégie qui instrumenterait l’erreur d’une manière positive, car elle est synonyme de tâtonnement expérimental nécessaire dans l’acquisition des savoirs et des savoir-faire.
Bibliographie : Des pratiques de l’écrit. Gisèle KAHN. Edition Hachette. Paris 1993. Situation d’écrit. Sophie MOIRAND. Edition CLE International. Paris 1979. L’Evaluation. Christine TAGLIANTE. Edition CLE International. Paris 1991. Apprendre à écrire le français au collège. J.C.MEYER et J.L. PHELUT. 1987. Des enfants non-francophones à l’école. Quels apprentissage ? Quel français ? Martine Abdallah PRETCEILLE. Ed. Armand Colin.Coll. Cahiers de pédagogie moderne N°66.Paris 1982. La dynamique de l’erreur. Daniel DESCOMPS. Edition Hachette-Education. Paris 1999. |
||||||||||||
|
ELABORER UNE PROGRESSION. 1.DÉFINITION : En pédagogie, une progression est une démarche didactique, une procédure rationalisée et économique d’enseignement aboutissant à la mise au point d’un modèle ou d’un itinéraire d’apprentissage, et qui implique des décisions relatives : - au choix des éléments à enseigner ou à privilégier dans l’enseignement ; - et à la mise en ordre de ces éléments suivant la stratégie qui semble la mieux adaptée aux buts recherchés ( facilité, rapidité, consolidation de l’apprentissage etc.) Pour l’enseignant, définir une progression c’est se donner un tableau de bord, une aide lui permettant de donner une cohérence interne à l’action pédagogique qu’il devra mener dans sa salle de classe durant l’année. Cette progression permet à l’enseignant d’avoir une vue d’ensemble du travail à faire et surtout d’inscrire chaque heure de cours dans un projet pédagogique qu’il se sera donné. 2.DEMARCHE. Le professeur dispose en début d’année scolaire d’un certain nombre d’outils dont l’utilisation consciente peut l’aider à mettre sur pied une bonne progression : son emploi du temps, le calendrier scolaire, les programmes, les manuels au programme, sa propre bibliothèque. A ces outils il devra ajouter une bonne connaissance de la classe. Toute action pédagogique ayant pour cadre une salle de classe, une bonne progression se construit d’une claire appréciation des savoirs, des savoir-faire et des lacunes des élèves dont on a la charge. C’est pourquoi, dès le début de l’année, le professeur soumettra la classe à une évaluation diagnostique qui fera apparaître les besoins réels de ses élèves et non seulement leurs besoins supposés. L’objectif d’ensemble étant de prendre les élèves là où ils se trouvent pour les mener le plus loin possible, c’est à partir des résultats de cette évaluation que s’élaborera la progression. L’emploi du temps fixe le cadre institutionnel dans lequel va se déployer l’action du professeur. Le calendrier de l’année scolaire une fois analysé, lui permet de déterminer l’enveloppe horaire globale dont il disposera. Les programmes énoncent les objectifs généraux et les notions à enseigner. Ces notions devront faire l’objet d’une analyse préalable pour faire émerger les contenus à enseigner. La progression à élaborer devra prendre en compte à la fois les contenus à enseigner ainsi mis en évidence et les besoins des élèves tels que l’évaluation diagnostique les aura révélés Les manuels ou à défaut les supports didactiques choisis par le professeur interviendront alors comme des outils permettant d’exécuter les enseignements ainsi programmés. Ils ne sauraient donc constituer en eux-mêmes un programme quelle que soit leur qualité. Le professeur y puisera en fonction des objectifs de telle ou telle leçon, des besoins de ses élèves en ce moment précis, des savoirs et des savoir-faire déjà acquis, de l’objectif général poursuivi par la séquence. Dans toute la mesure du possible, le professeur devra recourir à d’autres sources d’information pour lui-même et pour ses élèves. Une progression bien élaborée permet au professeur de donner une cohérence à son action, en lui fournissant une base pour procéder au décloisonnement de son enseignement. A titre d’exemple, pour une période dont le projet didactique majeur sera la rédaction d’une nouvelle en classe de 3èmeA.S, le professeur veillera à ce que toutes les activités de cours de français (lecture méthodique d’extraits, travaux sur les groupements de textes, cours de langue : grammaire et lexique etc.) aident effectivement les élèves à acquérir les compétences requises par l’exercice. Le professeur devra, pour motiver ses élèves, leur communiquer l’objectif retenu au début de chaque séquence ainsi que le détail des activités programmées pour atteindre cet objectif. |
comment gérer sa classe
|
CONDUIRE LA CLASSE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La plupart des grands spécialistes de la recherche en éducation ont tenté d'élaborer des modèles de l'enseignement efficace. L'efficacité d'un modèle suppose que l'enseignant en partage la théorie implicite. Il n'est donc pas question ici de développer un modèle. Nous nous bornerons à quelques conseils communément admis. Votre séquence (activité, leçon, unité didactique) ne pourra être efficace que si elle est une réponse.
« Toute leçon doit être une réponse » DEWEY. C'est-à-dire qu'elle doit répondre à un besoin. Nous n'apprenons que ce qui répond aux problèmes que nous nous posons. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DÉMARCHE POSSIBLE. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Présentation, lancement de la séquence - Proposer une situation problème dans laquelle la poursuite de la tâche impose de surmonter un obstacle. C'est cet obstacle qui justifie l'objectif de votre cours. - Mettre les élèves en projet de surmonter cette difficulté. - Communiquer de façon très brève les objectifs. - Tester les connaissances des élèves, sur le sujet. - Structurer ces connaissances. - Procéder par petites étapes à un rythme rapide. - Accompagner la présentation de questions visant à contrôler la compréhension. - Souligner les aspects les plus importants. - Fournir suffisamment d'illustrations et d'exemples. - Fournir des démonstrations et des modèles. 1.2. Pratique guidée - Guider les élèves dans les premières applications. - Poser de nombreuses questions et donner des exemples ouverts (avec le recours de matériaux divers). - Ne poser que des questions directement reliées aux nouveaux savoirs ou savoir-faire appris. - Contrôler la compréhension en évaluant les réponses fournies ou les comportements observés. - En cas de difficulté, faire parler l'élève sur sa manière de résoudre la tâche : "Dis-moi comment tu fais ? Qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Qu'est-ce que tu vois?..." - Favoriser le travail en petits groupes (2 ou 3). - S'assurer de la participation de chaque élève. - Fournir des suggestions pendant les applications. - La pratique guidée s'arrête quand l'élève peut travailler seul avec suffisamment d'assurance. 1.3. Correction - Les réponses correctes des élèves peuvent être suivies d'une autre question ou d'une brève reconnaissance du caractère correct de la réponse (par ex. : "C'est juste"). - Les réponses correctes mais hésitantes doivent être suivies d'un : "C'est juste. parce que…". - Les erreurs de l'élève doivent être l'indication d'un besoin d'applications supplémentaires. - Déceler chez les élèves les erreurs systématiques. - Essayer d'obtenir des élèves des réponses complètes. - Les corrections peuvent inclure une procédure de soutien, (simplification de la question, Indications pour faire avancer), des explications, des révisions, un rappel de la procédure ou un ré-enseignement des dernières étapes. - Les encouragements sont plus efficaces s'ils sont spécifiques plutôt que généraux. 1.4. Pratique indépendante - Programmer un nombre suffisant d'exercices à effectuer individuellement. - La pratique indépendante doit être étroitement reliée au contenu ou aux objectifs enseignés. - Les élèves doivent être avertis quand le travail individuel est contrôlé. - L'enseignant supervise activement le travail individuel dans la mesure du possible. 1.5 Retour à la situation problème de départ - Les élèves doivent être en mesure de franchir l'obstacle. - L'évaluation doit permettre de le confirme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
En résumé |
. Mettre les élèves en situation de projet, créer la motivation. . Organiser la participation des élèves, varier les rythmes. . Multiplier les travaux ( pour apprendre efficacement les élèves ont besoin d’agir, de manipuler, de s’entraîner, d’être actifs). . Suivre avec attention l’activité des élèves, soutenir, aider. . Evaluer les résultats. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
QUESTIONS A SE POSER OU A POSER A VOS COLLEGUES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
L’efficacité d’une conduite de classe dépend de la capacité de l’enseignant à organiser, communiquer, motiver, gérer un ensemble de phénomènes relationnels. Voici une série de questions à méditer. IL N’Y A PAS DE REPONSES TOUTES FAITES. Interrogez vos collègues et le conseiller d’éducation (le proviseur, le sous directeur des études) qui vous feront bénéficier de leur expérience et fixez-vous des règles. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SUR LA COMMUNICATION ORALE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les échanges collectifs • En début d'année est-ce que vous apprenez rapidement le nom et le prénom des élèves ? • Les tutoyez ou les vouvoyez-vous ? • Faites-vous attention à votre voix ? • Comment gérez-vous les interventions orales des élèves ? • Est-ce que vous avez des techniques verbales pour les valoriser ?
Les échanges élèves-élèves • Qu'est-ce que vous estimez tolérable ? • Comment intervenez-vous dans les autres cas ?
Les échanges professeur - élève • En cas de travail individualisé, répondez-vous au cas par cas ou bien dans un certain ordre ? • Acceptez-vous de répondre à une demande avant la mise au travail de tous ou bien la mettez-vous provisoirement de côté ? • Est-ce vous qui vous déplacez ou bien l'élève ? • L'échange a-t-il lieu a voix haute ou à voix basse ? le corps • Réagissez-vous à des attitudes corporelles décontractées (élèves appuyés aux murs, pieds sur les chaises….) ? • Acceptez-vous qu'ils gardent leur anorak ou leur couvre-chef ?
Les déplacements • Comment gérez-vous les entrées et les sorties de la salle de classe ? • Comment gérez-vous les déplacements dans la salle ? • Autorisez-vous les sorties en cours d'heure ? • Les élèves ont-ils le droit de sortir de la salle quand vous les avez deux heures ou plus ?
La présence : • Comment réagissez-vous quand un élève arrive ,en retard ? • Comment réagissez-vous quand un élève rentre sans frapper ? • Comment réagissez-vous aux absences longues d'élevés ? • Comment réagissez-vous aux absences perlées ou sélectives ?
Les règles de politesse • Avez-vous un code établi ?
Le conflit en classe avec un élève • Comment résolvez-vous le problème ? • Gardez-vous l'élève en fin d'heure pour un entretien ? Le conflit avec un groupe d’élèves ou la classe • Quel type de solution choisissez-vous ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SUR LA GESTION DE LA CLASSE. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les groupements • Selon quels critères groupez-vous les élevés en début d'année ? • Comment disposez-vous les tables dans la salle ? • En fonction de quelle activité ?
Les mises au travail • A quel moment remplissez-vous les différents registres (cahier de texte ou feuilles d'absences) ? • Ces tâches sont-elles déléguées à des élèves ? • Vous contentez-vous des registres administratifs d'absence ou bien jugez-vous utile d'en avoir un qui vous soit personnel ? • Quel moment choisissez-vous pour faire des communications qui ne concernent pas directement le cours ?
Le matériel de l'élève • Quel matériel demandez-vous ? Pourquoi ? • Faites-vous des vérifications de matériel ? Quand ? • Que faites-vous pour que les élèves sortent vite leur matériel en début de cours ? Le matériel de 1a salle • Faites-vous vous-même les tâches matérielles quotidiennes (tableau à essuyer, chaises à ranger, papier à ramasser) ? • Déléguez-vous ces tâches ? Selon quelles règles ?
L'évaluation • Avez-vous un système d'explication et de justification des notes que vous mettez? • Acceptez-vous de revenir sur une erreur d'évaluation que vous avez commise ?
Le travail hors classe (devoirs à domicile) • Comment vous assurez-vous qu'il est fait ? • Que faites-vous quand il n'est pas fait ? • Vous astreignez-vous à rendre les travaux dans des temps déterminés ? • Prenez-vous des mesures si les notes de leçons sont régulièrement au-dessous de la moyenne ? • Intervenez-vous dans les couloirs ? Dans la cour ? Devant l'établissement ? • Intervenez-vous auprès d'élèves que vous n'avez pas en classe ?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UTILISER LES DOCUMENTS INSTITUTIONNELS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1.Le cahier de textes de la classe C'est le Journal ou l'agenda de la classe. Il sert de référence pour les membres de l'équipe éducative, les élèves, l'administration et le corps d'inspection, doivent y apparaître, sous une forme accessible à tous, les activités échelonnées dans le calendrier : - progression dans l'étude ; - titres des leçons traitées, sujets et activités des travaux dirigés ; - énonces des contrôles (interrogations, devoirs, compositions); - indication des tâches effectuées par les élevés - énoncé des travaux à faire à la maison. Ces Informations constituent des éléments indispensables pour renseigner : - un élève qui désire vérifier qu'il n'a pas pris inexactement le texte d'un devoir ; - un élève qui a dû s'absenter ; - un suppléant qui prendra la classe en charge, en cas d'absence du professeur - l'administration et l'Inspecteur sur la marche de l'enseignement dans une classe déterminée. Sans en faire un journal analytique de la vie de la classe, on y verra un document justificatif fort précieux de l’activité du professeur et le support essentiel du dialogue entre les partenaires du système éducatif. 3.2 Le contrôle des absences Le professeur prend en charge le groupe dans la salle de classe, dans l’atelier, dans tout lieu qui devient lieu d'enseignement et quelquefois hors de 'établissement. La participation (ou la non-participation) des élèves à toutes les activités prévues à l'emploi du temps ou organisées par le professeur, doit être connue des familles qui confient leur enfant à l'institution. |
L'obligation, pour l’enseignant de vérifier la présence des élèves au cours est motivée : • par sa responsabilité juridique ; • par la sécurité à assurer à l'élève, vis-à-vis des familles qui connaissent les emplois du temps ; • par l'incidence de toute absence sur la validité et !a continuité du travail scolaire. On ne saurait apprécier des résultats trimestriels et annuels sans tenir compte de l'assiduité et de la présence aux cours. Cela implique que le professeur ait aussi, indépendamment du document fourni par l'administration, son propre registre de recensement des absences. Quelles que soient les modalités du contrôle des absences adoptées au sein d'un établissement, la constatation écrite de l'absence reste obligatoire à chaque séquence de travail. Grâce au recours à ces documents, suite à des cas d'accidents de trajet, de délinquance, d'agression dont des élèves ont été victimes ou auteurs, la personne publique et les personnels ont pu être dégagés de toute responsabilité. 3.3. La carnet de correspondance (ou de liaison avec la famille) Ce document est tenu par l'élève. Il est un moyen de liaison permanente entre l'établissement et la famille, la famille et l'établissement. Il apporte des informations diverses sur le fonctionnement du lycée, tant sur les plans pédagogique, administratif que professionnel. L'élève doit obligatoirement être en possession de ce carnet ; il doit le tenir avec exactitude et avec soin. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GERER L'INFORMATION |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.1 Le classeur de l’élève (cahiers) En fonction du type de classe et de l'âge des élèves, les exigences du professeur ne seront pas les mêmes. Quelques conseils • Définir en début d'année les règles d'organisation des cahiers : - faire apparaître le référentiel de la formation ; - dissocier les matières enseignées ; - diviser le classeur (le cahier) en différents chapitres (parties);
•Imposer rigueur et soin en ce qui concerne la présentation et l'orthographe. •Contrôler épisodiquement la tenue des cahiers. •Réfléchir préalablement au cours à la structuration des informations que les élèves devront noter (plan, paragraphes, définitions, ...). • Adopter des règles de présentation de manière à mettre en évidence les points clés du cours et de façon à faciliter l’utilisation ultérieure des documents. 4.2 le cahier de roulement C'est un classeur dans lequel sont regroupés et classés l'ensemble des documents remis aux élèves. Il est complété au fur et à mesure que se déroule la formation. Il constitue un double et un modèle du classeur des élèves. Il peut être consulté par les élèves qui doivent mettre à jour leur dossier (unités). Il est la mémoire de la classe dans une discipline donnée. 4.3 photocopies Ce sont des documents qui permettent de gagner du temps durant la séquence. Ils peuvent être conçus de telle sorte que les élèves aient à les compléter. Constituant des modèles, Ils doivent être irréprochables d'un point de vue technique (rigueur professionnelle, respect des normes. lisibilité....). |
|
Quelques conseils • Lorsque les élèves manipulent de nombreux documents. Il est souhaitable d'adopter un mode de repérage (sigles, codes, pagination, ...) et de leur faire rassembler ces documents dans des pochettes plastique. •Il est inutile de photocopier des documents présents dans des ouvrages que les élèves possèdent. • 11 est préférable de faire chercher l'information dans un document technique ou professionnel que de la livrer hors de son contexte (quand cela est possible). • Rien ne remplace un bon ouvrage scolaire (quand il existe). 4.4. LES MANUELS. Consultez les collègues de la spécialité pour connaître les ouvrages utilisés dans la discipline. De même, renseignez-vous en ce qui concerne les procédures d'achat des ouvrages, en fonction des classes: achat par l'établissement ? achat par l'élève? commande groupée ? coopérative scolaire?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UTILISER LE TABLEAU ET LE RETROPROJECTEUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
L’ordinateur, la vidéo, le rétroprojecteur et le tableau sont les outils de communication du professeur. Nous n’aborderons, ici, que les deux supports les plus exploités : le tableau et le rétro projecteur. Ce sont deux outils complémentaires. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tableau |
Rétroprojecteur |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Support de l'écrit ou de schémas très simples qui ne prennent pas trop de temps en réalisation. *Support de représentations statiques. *Une fonction d'information : - objectifs de la séquence, - étapes. *Une fonction d'interaction professeur / élève : - exploitation des réponses élèves. - essais, exercices, - brouillon. *Une fonction mémorisation : - messages permanents, - synthèses, résumés, - mots clés, formules, règles |
|
|
*Support d'images complexes : - plans, schémas, photos, - tableaux, diagrammes, *Support attractif : - simulation de mouvement, maquette, - Jeu d'images (superposition, glissement,...) *Exploitation rapide et interactive ; - images éphémères, - présentation, commentaire, animation. *Support d'analyse : - fonctionnelle, - structurelle. - temporelle. *Préparation en amont. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.1 structurer le tableau Afin d'exploiter au mieux le tableau, Il peut être utile de diviser l'espace en trois secteurs. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Un espace réservé à l'informationrelative au déroulement de la séquence : • objectifs. • étapes. Cet espace n'est pas effacé durant la séquence. Les élèves savent ainsi, à tout moment, où ils en sont dans le déroulement de la séquence et ce qui leur reste à faire. |
Un espace réservé aux notions fondamentales abordées durant le cours : • principes, • formules, • vocabulaire, • procédures. L’information reste affichée tant que possible. La stabilité de l’information permet la mémorisation. |
Un espace brouillon : • démonstrations rapides, • réponses des élèves.
Cet espace est régulièrement effacé en fonction des besoins. C’est un espace de travail et d’interaction avec la classe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 activités de production orale
4 ACTIVITÉS de PRODUCTION ORALE :
PRODUCTION ORALE, DES PISTES :
Je vous propose aujourd’hui 4 idées pour travailler la production orale à différents niveaux et ce, de manière ludique.
En tant qu’enseignant, je suis toujours à la recherche d’idées nouvelles (ou juste d’idées) pour faire pratiquer mes apprenants. Je partage donc ces activités que je garde toujours pas très loin et que je ressors à différents moments dans une formation.
QUAND ?
Cas de figure 1 : un remplacement, un espace vide …
Quand on est prof, on doit parfois improviser, trouver une activité de dernière minute (il n’y a qu’à moi que cela arrive?). Loin d’être l’idéal de notre pratique, soyons réalistes, nous sommes tous à un moment ou à un autre en recherche d’une idée lumineuse quelques instants avant un cours.
En cas de besoin, je garde dans ma boite de secours quelques activités très simples à mettre en place, sans matériel (car on n’a pas toujours le matériel à disposition…)
Cas de figure 2 : je cherche une activité « communicative » à intégrer à une séance en particulier
Après avoir aborder des compétences langagières à remettre en contexte ou après avoir travailler une thématique, certaines de ces activités peuvent s’adapter à vos besoins ou en proposer des variantes.
UNE LISTE DE PROPOSITIONS :
1/ Le jeu du menteur
Niveaux : Tronc commun lettres ou sciences
Objectifs : le récit au passé, raconter une anecdote, mentir !
Déroulement : Individuellement, les apprenants doivent réfléchir à deux anecdotes à raconter à leurs camarades. Le problème ? L’une est vraie, l’autre est inventée. Après un temps de préparation, en groupes, ils racontent ces histoires (en donnant un maximum de détails pour être le plus convaincant possible). Les auditeurs doivent ensuite poser des questions (précises) pour évaluer si le narrateur ment ou non. N’hésitez pas à élire le meilleur menteur du groupe.
Utilisations- retours : Il m’arrive d’utiliser cette activité de production orale en début de cours pour évaluer la maitrise du récit au passé, mais aussi lors de séances de travail autour du faits divers. En passant dans les groupes, lorsque mon objectif est de travailler le récit au passé, il est important de corriger ou d’attirer l’attention des apprenants sur le maintien du passé tout au long de leur discours. (tout en s’intéressant au sens de leur récit, entendons-nous bien). Cette activité s’adapte à plusieurs niveaux, vos attentes seront justes différentes.
***************************************************************************************************************************************************************
2/ Les naufragés
Niveaux : première Bac pour travailler l’argumentation
Objectifs : convaincre, trouver des arguments, argumenter en interaction ou en continu
Déroulement : vous définissez des métiers, des personnages qui seront distribués au hasard aux apprenants. Vous leur expliquez ensuite cette terrible situation : “ils sont tous sur un bateau qui va couler, il y a seulement un canot de sauvetage mais seulement X personnes peuvent monter.” (Définissez combien de personnes suivant votre groupe). Ils doivent donc trouver des arguments convaincants, expliquer en quoi ils seront utiles etc.
Vous pouvez mettre en place deux suites : soit chacun dispose d’un temps pour exposer et convaincre soit, beaucoup plus amusant avec un petit groupe, vous les invitez à en débattre ensemble et encouragez chacun à aller prendre la parole
Utilisations- retours : Cette activité fonctionne très bien avec de grands adolescents mais aussi avec des adultes. C’est aussi un moyen pour travailler avec eux les structures permettant d’aller prendre la parole aux autres, rebondir sur idée; parce que cela s’apprend également. Je fais souvent une liste de ces outils au tableau pendant l’activité : “oui… mais” , “Je ne suis pas du tout d’accord”, “attends” etc …
*******************************************************************************************************************************************************************
3/ Les objets extraordinaires – le concours
Niveaux : Tronc commun / première Bac / deuxième Bac
Objectifs : inventer et décrire un objet extraordinaire puis présenter son projet.
Déroulement : le mieux consiste à partir d’une séquence de découverte d’objets extraordinaires dont vous trouverez des exemples sur internet par exemple ou dans des œuvres littéraires. J’avais déjà fait allusion à cette activité dans un article précédent en parlant du piano cocktail. Après cette première activité, proposez à vos apprenants de devenir inventeurs et de créer en groupe un objet extraordinaire. Chaque groupe devra présenter son projet aux autres en expliquant son fonctionnement, ses qualités, en le décrivant (selon vos objectifs, vous pouvez définir des contraintes)
Utilisations- retours : cette activité basée sur le créatif fonctionne avec tous les âges. Vous pouvez aussi en profiter pour faire un peu de culturel et leur faire découvrir le concours Lépine. N’hésitez pas à mettre une série de prix au tableau qui devront être décernés (le prix de l’objet le plus fou, celui du plus futuriste etc…)
********************************************************************************************************************************************
4/ Un sondage
Niveaux : Tronc commun / première Bac
Déroulement : le sondage est une activité parfaite pour travailler à la fois des structures (poser des questions) tout en mettant en contact les apprenants avec l’extérieur ou avec d’autres apprenants. Les apprenants devront mettre à l’épreuve leurs compétences de production et de compréhension en interaction. Le temps de préparation des questions et des items est aussi très important pour le travail sur la langue.
Utilisation- retours : En adaptant au niveau, en choisissant des thèmes en relation avec les intérêts de vos apprenants, cette activité devient très motivante. N’oubliez pas aussi de proposer une modalité de partage des résultats (affiches etc … )
Quelques pistes indispensables pour intégrer les TICE dans sa classe
FEEDLY : TROUVER DES ARTICLES DE PRESSE ET LES INTÉGRER À VOS DOCUMENTS DE COURS
Cet article se présente en deux parties pour vous guider dans l’utilisation d’un logiciel d’abonnement au flux RSS. Cette première section vous propose de découvrir cet outil et son interface.
Tous ceux qui utilisent des documents authentiques pour leurs cours savent à quel point la recherche d’articles et leur intégration aux documents de cours est chronophage. Je vais donc ici partager deux trois petits trucs qui pourront vous faire gagner un peu de temps.
RSS MON AMI !
Vous avez tous déjà remarqué cette petite icône sur les sites de presse, les blogs etc. sans peut-être savoir à quoi elle servait. C’est tout simplement un lien vers un fichier RSS et selon moi, une révolution technologique. En effet ce fichier va vous permettre de vous abonner à un site ou une rubrique et vous n’aurez plus à aller consulter un site pour voir si quelque chose de nouveau a été publié puisque vous serez informé en temps réel de toutes les nouvelles publications. En gros vous n’allez plus sur un site, c’est le site qui vient à vous ! Là vous me direz « mais quel intérêt ? » et vous aurez raison parce que l’abonnement à un flux RSS ne prend tout son sens que si vous vous abonnez à plusieurs sites en même temps et si vous utilisez un service qui vous permettra de gérer vos abonnements. De cette façon vous retrouverez dans une seule page un résumé de tous les nouveaux articles parus sur différents sites et blogs sans avoir à aller sur aucun de ces sites.
FEEDLY : COMMENT FAIRE ?
Plusieurs services peuvent vous permettre de gérer vos abonnements RSS mais je me contenterai aujourd’hui de vous présenter Feedly. Feedly est un service en ligne mais aussi une application iPhone, iPadet Android gratuits qui utilisent votre compte Google. Quand vous arrivez sur la page de Feedly, vous pouvez commencer par ajouter des abonnements présélectionnés par thèmes et vous avez aussi le choix des langues en bas à gauche de l’écran. Cliquez sur un des thèmes et vous aurez déjà toute une série de propositions de sites les plus connus. Si vous voulez une catégorie qui n’apparait pas dans la présélection, il vous suffira de la taper dans le champ de recherche en haut à gauche.
À partir de ce moment, vous pouvez donc choisir les sites qui vous informeront de leurs dernières publications en cliquant sur les sites puis sur tout en haut. Là on vous demandera d’entrer vos identifiants Google ce qui présentera l’avantage de retrouver vos abonnements sur n’importe quel ordinateur et sur vos tablettes ou smartphones. Vous pouvez maintenant ajouter n’importe quel site qui utilise un flux RSS et les classer par catégories pour obtenir quelque chose qui ressemble à cela :
Dans le cercle rouge, vous voyez le nombre d’articles non lus et dans l’ovale vert l’ensemble de vos abonnements dans une catégorie précise. Lorsque vous cliquez sur un article dans la partie droite, vous pouvez lire l’article ou une partie (selon ce que le développeur du site source a autorisé). Vous avez alors plusieurs options :
Je ne parlerai pas d’Instapaper et de Pocket ici mais sachez simplement que ce sont des services (web et applications) qui vous permettent de sauvegarder des articles pour les lire hors connexion (pratique dans le métro).
Voici donc la démarche pour ajouter des sites présélectionnés par Feedly. Dans le second article, nous verrons la démarche pour les autres sites.
FEEDLY 2 : VOTRE CONTENU
FEEDLY: ABONNEZ-VOUS AU CONTENU DE VOTRE CHOIX
Dans l’article précédent, nous avons vu comment ajouter des sites présélectionnés par Feedly mais quid des autres ? Dans Feedly, en haut à gauche vous avez deux options : « My Feedly » et « + Add Content ». « My feedly » vous donne accès à tous vos abonnements alors « + Add content » vous permet d’ajouter de nouveaux abonnements comme au début. Vous pouvez alors taper le nom d’un site et Feedly vous proposera de vous abonner (toujours si le site utilise un fichier RSS) et il ne vous restera plus qu’à cliquer sur le site que vous cherchiez (ici je vous recommande fortement la 2ème proposition de l’image ;)) et de choisir la catégorie dans laquelle vous voulez que l’abonnement apparaisse.
Il se peut enfin que Feedly ne trouve pas le site que vous cherchiez, dans ce cas allez sur le site auquel vous voulez vous abonner et recherchez le bouton. Cliquez sur ce bouton peut donner des résultats divers et variés :
Dans ce cas, copiez juste l’adresse qui se trouve dans la barre d’adresse de votre navigateur, collez-la dans le champ de recherche de Feedly et vous pourrez vous abonner.
C’EST BIEN MAIS APRÈS JE FAIS QUOI ?
Maintenant vous pouvez rapidement, à partir d’une seule fenêtre de votre navigateur, voir toutes les mises à jour de vos sites favoris, sauvegarder les articles pour plus tard ou les partager. Cependant souvent quand on conçoit un document de cours, on aime y intégrer des articles. En général, on se rend sur le site de l’article, on sélectionne le texte et on fait un copier-coller qui peut avoir des résultats surprenants : texte dans un tableau qui dépasse le format de la page, présence de publicité, police trop petite pour le corps du texte et trop grande pour le titre etc, etc… On passe donc plusieurs minutes à refaire la mise en page. Pour éviter ce travail ingrat un petit utilitaire qui s’intègre à Chrome (une extension) fait des merveilles. Il s’agit de Clearly.Sur la page de Clearly, cliquez sur « Download for Chrome » puis « add » et vous aurez une magnifique lampe de bureau qui s’ajoutera à Chrome à côté de la barre d’adresse :
Et voilà, quand vous allez sur un site avec un article qui vous plait, cliquez sur la petite lampe et c’est magique !
AVANT
APRÈS
CLEARLY: LA BARRE D’OUTILS
Arrêtons-nous un peu sur la barre d’outils qui se trouve sur la droite :
Et voilà, vous avez un texte épuré avec la police qui vous plait, vous pouvez faire votre copier-coller sans souci de mise en page. Si vous connaissez d’autres outils du même style n’hésitez pas à les partager dans les commentaires !
LEARNINGAPPS : CRÉER DES EXERCICES INTERACTIFS
LEARNINGAPPS : UN SITE INTERNET QUI MÉRITE QU’ON PARLE DE LUI.
Learningapps.org est un site internet malin (et non pas une application pour tablettes, contrairement à ce que l’on pourrait penser…) que tout prof devrait garder dans ses favoris.
Développé par la Haute Ecole Pédagogique de Berne et accessible en cinq langues, ce site internet vous offre la possibilité de créer vos propres exercices interactifs ou de choisir parmi ceux déjà existants. Et oui, les contributions de chacun sont mises au profit de tous.
LEARNINGAPPS : DES EXERCICES VARIÉS!… OUF! ENFIN!
Le site nous propose une grande variété d’applications dans des domaines, eux aussi, très variés. Avec ce créateur d’exercices, vous allez sans doute définitivement dire adieu au désormais dépassé, Hot Potatoes. Si vous ne l’aviez pas déjà oublié…Questions à choix multiples bien sûr, mais aussi Classements, Mise en ordre, Memory, Mots croisés, Associations, Textes à trous…tout, tout, tout, (ou presque) vous trouverez tout sur LearningApps.org.
LEARNINGAPPS : UNE UTILISATION SIMPLE
La création des activités appelées “Apps” est bien pensée et particulièrement simple.Un titre, une consigne, les questions et réponses attendues, le petit mot de félicitations et quelques choix de mise en forme (image de fond, etc …), bref les éléments indispensables pour ce genre d’outil. Le site permet également de créer un compte et un profil afin d’enregistrer les apps que vous créez.
LEARNINGAPPS : POUR QUELLE UTILISATION?
Une fois finalisés, ces exercices sont ensuite modifiables et intégrables sur un site internet ou un blog via HTML ou sur une plateforme LMS via la norme SCORM. Le site propose même la création automatique du QR Code de l’activité. C’est une petite pépite pour les profs qui souhaitent proposer des exercices complémentaires, de renforcement ou de remédiation à leurs étudiants sans les accabler! Les exercices se veulent volontairement simples et ludiques.
L’EXEMPLE D’UN EXERCICE SUR LES ADJECTIFS POSSESSIFS
En conclusion, je recommande vivement l’utilisation de LearningApps!
THINGLINK : UNE APPLICATION TABLETTE POUR TRAVAILLER LES VISUELS EN CLASSE
PRÉSENTATION RAPIDE
Thinglink est un service en ligne et une application tablette gratuite (iOS et Android) qui permet de créer et partager des images interactives sur lesquelles apparaissent des infobulles cliquables, pointant vers d’autres médias (vidéo, audio, texte, lien, etc …). A partir d’une simple photo, l’enseignant ou les apprenants peuvent alors enrichir le thème ou les éléments figés d’un support photo, qui « prennent vie » sous forme de compléments multimédia. Cet outil peut se révéler particulièrement efficace pour synthétiser un voyage, conceptualiser une règle de grammaire ou illustrer une page de lexique, entre autres.
Comme pour le dernier article sur Popplet, je me focaliserai essentiellement sur l’application qui présente un certain nombre d’avantages sur le service en ligne, en termes de fluidité, accessibilité et mobilité dans l’usage en lui-même. En fin d’article, je résumerai toutefois quelques petites différences notoires entre ces 2 dispositifs.
LES PREMIERS PAS AVEC THINGLINK
Après avoir installé l’application et configuré votre compte (via e-mail, facebook, twitter ou google +), vous pouvez créer votre première image interactive en la choisissant soit dans votre galerie de photos ou soit en la prenant directement via la tablette.
Une fois celle-ci uploadée, vous avez le choix d’y insérer un ou plusieurs points multimédias à l’emplacement que vous souhaitez. Il est ainsi possible d’encapsuler un lien, un son, une vidéo… Chaque contenu ajouté à votre photo sera représenté par un pictogramme de couleur et à son survol, une infobulle dévoilera le contenu du lien et redirigera vers le site, le blog, la plateforme, … configurée. Cliquez sur l’image ci-dessous pour avoir le rendu :
SON UTILISATION
Alors quelle est son utilité en classe de langues ? Prenons un exemple basique : la mémorisation du lexique. Dans une classe traditionnelle, les apprenants n’ont guère le choix de mémoriser les mots qu’à travers des listes ou des phrases en contexte. Si cet exercice s’avère « relativement » utile, on peut le rendre encore plus souple et efficace en associant tous les canaux de réception, à savoir l’image, le son et le texte. Pour un même mot, l’apprenant aura alors la possibilité de le lire, de le visualiser et de l’entendre, ce qui rendra la mémorisation plus aisée. Voici un petit exemple pour les niveaux A1 (cliquez sur l’image pour avoir le rendu)
Vous avez donc compris le principe… C’est l’exploitation la plus basique de Thinglink. Maintenant, on peut pousser un peu plus loin la réflexion en demandant aux apprenants de se servir de la tablette pour photographier eux-mêmes leur environnement (objets et lieux du quotidien), leur manuel (page de grammaire ou de culture) ou même le tableau de la classe pour pouvoir restituer les éléments acquis sous forme de synthèse « multimédia ». Cela permet de mettre en place très simplement 2 notions essentielles dans tout apprentissage : la conceptualisation et la collaboration entre pairs.
En élargissant les possibles, on pourrait imaginer une utilisation de Thinglink pour :
- une photo de votre voisin(e) de classe avec son pays de naissance, ses loisirs, ses plats préférés, etc …
- un fait historique en y associant tous les média (son, vidéo, texte)
- une carte interactive pointant sur les lieux visités (panorama, vidéos, textes, critiques de lieux ou restaurants, etc …)
- une photo d’un auteur avec sa biographie, ses œuvres, etc
- A vous d’imaginer la suite ….
SERVICE EN LIGNE VS APPLICATION
L’application permet une mobilité totale avec une fluidité très agréable dans toutes les étapes de la création (prise de photo, ajout de média, enregistrement et publication) réunies sur le même outil, à la différence du service en ligne qui demande au minimum 2 matériels (ordinateur + appareil photo). Cependant, ce dernier s’avère plus complet sur l’étape d’édition en proposant plus de variantes de pictogrammes et un moteur de recherche média plus fourni. Pas de panique, les 2 services étant liés au même compte, les fanatiques de l’esthétisme pourront très bien commencer le travail par l’application et finaliser le tout via le service en ligne.
CONCLUSION
L’application Thinglink dispose d’un gros potentiel pour un usage en classe, quand il s’agit d’enrichir des supports qui pouvaient paraitre jusqu’à présent figés. A travers cet outil, l’enseignant a ainsi la possibilité de réunir sur un même support des éléments s’adaptant remarquablement aux différents styles d’apprentissage de ses apprenants. Petits conseils pour la gestion en classe : préférez le travail par petits groupes, chacun ayant une tâche particulière à accomplir. Prévoyez toujours la restitution des productions en vidéoprojection (Tablette + vidéoprojecteur) pour favoriser l’évaluation entre pairs. Enfin, n’oubliez pas de publier ces travaux sur le blog ou le portfolio de la classe pour maintenir le suivi des apprentissages.
30 fiches de leçons de langue à exploiter sans modération
Fiche1 : Se présenter, présenter quelqu’un
SE PRÉSENTER
I. SE PRÉSENTER VOLONTAIREMENT A DES INCONNUS :
Moi, c’est Anne, et toi ?
Je me permets de me présenter, Pierre Martin.
Je suis l’oncle de la mariée.
Bonjour, nous sommes voisins. Venez prendre le café chez nous.
1. Décrivez la situation dans laquelle chaque phrase est prononcée.
2. Quelles informations les personnages donnent-ils sur eux-mêmes ?
3. À quel type de relation correspond chaque phrase ? (amicale, familiale, officielle.)
II. SE PRÉSENTER OBLIGATOIREMENT A DES INCONNUS :
Je m’appelle Anne Bernard, étudiante en sociologie, je fais une enquête.
Vous ne me connaissez pas, mon nom est Marc Benoît, je viens de la part du gardien.
Excusez-moi, je suis la voisine du bas, vous avez une fuite dans votre appartement.
1. Dans quelles situations ces phrases sont-elles prononcées ?
2. Quelles informations chaque personnage donne-t-il sur soi ?
3. Qu’est-ce qui précède la phrase de présentation ? Pourquoi y a-t-il cette introduction ?
III. SE PRÉSENTER DANS UNE RELATION PROFESSIONNELLE
Hervé Chamanier, directeur de l’agence Alpha.
Jacques Boreau, votre nouvel inspecteur.
Isabelle Miracle, journaliste au Figaro.
1. Dans quelles circonstances ces phrases pourraient être prononcées (réunion, débat, conférence…) ?
2. Quel type d’informations donne-t-on sur soi ?
IV. SE PRÉSENTER POUR DEMANDER DU TRAVAIL :
Je m’appelle Hélène Druc, je vous téléphone au sujet de l’annonce que vous avez fait passer dans l’Écho des Alpes.
Je m’appelle Mme Martin, je suis secrétaire depuis 15 ans, j’ai travaillé pendant 10 ans pour la société Mina et 5 ans pour la société Belzec qui vient de déposer son bilan…
Je me présente, Marc Burna, j’ai 23 ans et je suis dégagé des obligations militaires, j’ai un D.U.T. en gestion, j’ai fait un stage de trois mois chez M. X. Je suis intéressé par votre annonce.
Résumé
Dans certaines situations, ne pas se présenter est considéré comme une impolitesse.
Les formules utilisées ne sont pas très nombreuses, mais les informations que l’on donne sur soi dépendent de la situation et de la personne à qui l’on s’adresse.
On se présente dans des relations amicales, dans des relations de travail et au téléphone.
Remarque :
Si un adulte ou un personnage haut placé vient en visite officielle sur votre lieu de travail, il est impoli de vous présenter sans qu’il vous le demande
Exercices
Présentez-vous devant la classe, chacun à votre tour, en indiquant votre prénom, votre nom, votre âge, vos goûts, etc..
Vous vous présentez au secrétariat du collège pour demander des renseignements sur la cantine (prix, mode de paiement, ordre de passage…)
Vous vous présentez à vos voisins de palier qui viennent de s’installer pour leur proposer votre aide.
Vous allez voir le professeur d’école de votre petit frère, vous vous présentez.
Vous vous présentez au téléphone pour demander un renseignement.
Formules à utiliser, à l’oral comme à l’écrit :
Je m’appelle…
Je me présente…
Je me permets de me présenter…
Je suis…
Permettez-moi de me présenter…
PRÉSENTER QUELQU’UN
Nous avons le plaisir d’avoir parmi nous ce soir : Jacques Martin.
Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous présenter un de nos collaborateurs les plus dévoués : Monsieur Dumur.
Vous connaissez Claire ? Elle vient de s’installer dans le quartier.
Voilà Estelle, la copine dont je te parle souvent.
1. Dans quelles circonstances ces phrases sont-elles prononcées ?
2. Quelles informations donne-t-on sur la personne que l’on présente ?
3. Pourquoi ne donne-t-on pas d’informations sur la personne dans la première vignette ?
4. Quelles relations peuvent exister entre les trois personnages dans les trois autres vignettes ?
Résumé
Dans certaines situations, il est indispensable de présenter les gens les uns aux autres.
Dans toute relation, on présente les deux personnes mais on commence par la dernière arrivée.
On présente « l’inférieur » au « supérieur », un monsieur à une dame, le plus jeune au plus âgé.
Dans des relations officielles ou professionnelles, on donne le titre de la personne que l’on présente pour l’honorer ou parce qu’on a peur qu’une des personnes présentes ne fasse une gaffe :
Monsieur Girard, contrôleur des impôts…
Le Docteur Gaëlle Miroux, médecin chef de l’hôpital…
Lorsque l’on a une relation de parenté avec la personne que l’on présente, il faut la préciser :
Madame X, ma sœur… ; Mes parents…
Selon la situation, les réponses possibles sont :
- Bonjour monsieur…
- Bonjour madame…
- Enchanté(e) de faire votre connaissance
- Salut !
Ah ! J’ai souvent entendu parler de vous…
Je suis ravi de vous connaître car j’ai souvent entendu parler de vous…
Exercices
Vous êtes invité chez des amis, vous présentez votre frère que vous avez emmené et qui n’est pas invité.
Vous présentez un de vos amis à vos parents.
Vous êtes présentateur de télévision et vous présentez une personne célèbre.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 6e, Nathan, 1996.
Fiche2 : Donner son avis
Observons
Une conversation familiale
- Renault vient de sortir une nouvelle voiture.
- À mon avis, elle est trop chère.
- Admettons ! C’est bien possible.
- Pour moi, je la trouve moins bien que la Peugeot.
- C’est exactement ce que je pense.
- Ce qui me paraît important, c’est le freinage ABS.
- Je ne te le fais pas dire !
Réfléchissons
1. Quelle phrase présente une affirmation ?
2. Quelles phrases expriment un point de vue personnel ?
3. Quelle phrase nuance le point de vue ?
4. Quelle phrase évalue en comparant deux éléments ?
5. Quelles phrases expriment nettement un accord ?
Leçon
Comment exposer votre point de vue personnel
C’est mon opinion. — Moi, je pense… — À mon avis… — En ce qui me concerne… — Je crois… — Je suis d’avis que… — J’estime que… — Je suis persuadé (e) que… — D’après moi,… — Pour moi… — Ce qui me paraît important, c’est… — Moi, personnellement… — Pour ma part… — Mon idée, mon sentiment, mon opinion, c’est que… — De mon point de vue… — Ce qui compte à mes yeux, c’est — Telle est ma conviction… — Je n’en sais rien — Je n’ai pas d’opinion sur la question —
Comment faire une objection
Ça dépend — Oui, mais tout de même… — Par contre… — Je me demande si… — Il ne faut pas oublier que… — Il ne faut pas perdre de vue que… — Je voudrais vous faire remarquer que… — Il faut également considérer que… — Vous avez oublié de dire que… — Vous avez peut-être raison mais… — Je ne comprends pas pourquoi… — Vous ne me ferez pas croire que… — Ne serait-ce pas plutôt… — Est-ce qu’il ne faudrait pas plutôt… — Est-ce qu’on ne pourrait pas plutôt dire que… —
Comment nuancer son point de vue
Il me semble que… — Tu ne trouves pas que… ? — J’ai l’impression que… — Sans doute — Sûrement — Peut-être bien que… — C’est bien possible — En principe — Admettons — Si vous voulez — On peut dire ça — Pourquoi pas ! Je n’y avais pas pensé.
Comment demander des informations supplémentaires
Je ne sais pas si j’ai bien compris, mais… — Que vouliez-vous dire par là ? Que veut dire… ? Pouvez-vous préciser votre pensée ? — Pouvez-vous m’expliquer… ?
Comment exprimer son accord
J’approuve… — Je suis d’accord avec (+ nom) — Je suis pour (+ nom ou infinitif) — Je suis pour que (+ subjonctif) — Je suis favorable à… — Je suis favorable à ce que — Je suis (absolument/résolument) partisan que — Je suis convaincu que… — Je suis persuadé/certain/sûr que… — Je suis tout à fait/absolument d’accord. — Je suis entièrement de ton avis — Vous avez raison. — C’est évident — Évidemment — C’est exactement ce que je pense — Il n’y a pas à discuter là-dessus — Bien sûr ! — Sans aucun doute — Naturellement — Je te l’avais dit — Je ne vous le fais pas dire.
Comment exprimer son désaccord
Je ne suis absolument pas d’accord ! — Je ne suis pas d’accord du tout ! — Absolument pas ! Vous avez tort. — Ce que vous dites est absurde — Ce n’est pas tout à fait mon avis — Je ne suis pas d’accord avec vous sur ce point. — Vous avez tort de soutenir ce point de vue — Je ne pense pas que vous ayez tout à fait raison — Je regrette, mais il m’est impossible de partager votre avis — Je ne suis pas sûr que cette méthode soit parfaitement adaptée.
Résumé
Donner son avis, c’est apprécier de façon positive ou négative, d’une manière nette ou nuancée, en sachant évaluer le problème ou la situation sur laquelle on vous demande de vous exprimer.
Exercices
Par groupes, improvisez les scènes suivantes, et donnez votre avis en employant le vocabulaire adapté à l’interlocuteur et à la situation.
1. Vos parents décident qu’on ne regardera plus la télévision pendant les repas.
2. Votre grande sœur essaie les vêtements qu’elle vient de recevoir par colis. Elle vous demande votre avis.
3. Votre père veut que vous l’appeliez par son prénom.
4. Aimez-vous, ou aimeriez-vous porter des vêtements de marque ? Donnez votre avis.
5. Votre frère apporte sur la table le gâteau dont il vient d’improviser la recette.
6. Vous venez d’essayer un nouveau jeu vidéo. Vous donnez votre avis à un copain.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 6e, Nathan, 1996.
Fiche3 : Interroger
Observons
a) Deux filles dans une cour de récréation
Hélène ! En forme, T’as fait quoi ce week-end ?
b) Les mêmes en cours
Monsieur, s’il vous plaît, quelle est la date du prochain contrôle ? Que doit-on réviser ?
c) Un des deux personnages précédents dans sa chambre. Entre le frère.
Estelle, je te dérange ? Tu veux bien me faire plaisir ? Est-ce que tu peux me prêter ton CD de Nirvana ?
d) Un des deux personnages précédents devant son père
Pourrais-tu signer mon bulletin ?
Dis donc, tu peux me dire ce que signifie ce zéro en orthographe ?
Réfléchissons
1. Analysez les situations de communication en vous aidant du tableau suivant :
2. Pour chaque situation, précisez si la question appartient au registre familier ou au registre soutenu.
3. Précisez si la question est totale (on peut y répondre par oui ou par non) ou partielle. Justifiez votre réponse.
4. Précisez les rapports qui existent entre celui qui interroge et celui qui est interrogé.
Leçon
Comment poser une question totale
On pose une question totale quand on veut un accord ou un refus. La question porte sur le verbe de la question.
Vous êtes Italienne ?
Est-ce que tu as tes clefs ?
T’as révisé ta leçon d’histoire ?
Avez-vous voté aux dernières élections ?
Comment poser une question partielle
On pose une question partielle quand on désire un renseignement particulier : qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi.
Comment t’appelles-tu ?
Quel âge as-tu ?
Combien as-tu de frères et sœurs ?
Combien as-tu payé ton blouson ?
Quelle est la marque de ta voiture ?
Les fausses questions
Dans certains cas, celui qui interroge n’attend pas de réponse. Si l’interrogé répond, il se montrera insolent : ce sont de fausses questions.
Un père à son fils :
— Tu veux une gifle ?
— Tu me prends pour un imbécile ?
Un professeur à ses élèves agités :
Vous avez bientôt fini ?
Comment poser une question orientée
On peut poser une question de manière à induire la réponse que l’on souhaite obtenir.
Les baleines sont des mammifères, n’est-ce pas ?
Avez-vous jamais vu quelqu’un d’aussi désordonné ?
Crois-tu que je vais continuer à ramasser toutes les affaires que tu laisses traîner ?
Est-il normal que je mette toujours la table toute seule ?
Ne vaudrait-il pas mieux que tu arrêtes de fumer ?
Tu viendras me voir dimanche, j’espère ?
Ne valait-il pas mieux prendre le risque de l’opération plutôt que de le laisser dépérir ?
Comment ne te reconnaîtrai-je pas ? Nous étions ensemble au CP !
Et ce ne serait pas possible de lire dix pages par jour ?
Résumé
On interroge pour :
— demander un accord ou un refus
— demander une information
— s’imposer à quelqu’un
— faire une enquête ou un sondage.
On interroge :
— par des questions totales ou partielles
— par de vraies ou de fausses questions
— dans un registre familier ou soutenu suivant la situation de communication.
Exercices
Improvisez, à deux ou à plusieurs, quelques-unes des scènes suivantes, en utilisant quelques-unes des tournures précédentes.
1. Vous voulez faire plus ample connaissance avec un nouvel élève. Posez-lui des questions.
2. Vous arrivez très en retard à un match de football. C’est la mi-temps. Vous rejoignez un copain et vous lui demandez ce qui s’est passé avant votre arrivée et où en est votre équipe favorite.
3. Vous tenez le bureau des objets trouvés à la fête de l’école. Une dame vient demander si quelqu’un a rapporté son parapluie ou son portefeuille. Vous lui posez des questions pour qu’elle vous décrive l’objet.
4. Il y a eu une explosion dans l’immeuble voisin. Journaliste, vous enquêtez sur ce fait-divers. Pour écrire votre article, vous allez poser des questions aux témoins.
5. Vous êtes cosmonaute. Vous avez passé dix ans dans l’espace. Vous revenez chez vous, dans votre famille et votre ville ou votre village. Vous demandez ce qui s’est passé au cours de cette longue absence.
6. Vous avez encore oublié vos copies doubles, pour la vingtième fois de la semaine. Vous essayez d’en emprunter une à votre voisine excédée.
7. Un de vos copains est allé plus loin que vous dans un jeu vidéo ou dans la construction d’une maquette que vous avez abandonnée. Vous lui posez des questions pour lui demander de l’aide.
8. Vous voulez que le professeur de français reporte de trois jours la date de remise de la rédaction. Posez-lui des questions orientées.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 6e, Nathan, 1996.
Fiche4 : Porter un jugement
Observons
Un groupe d’élèves de 6e à la piscine, devant une vitrine, à la sortie d’un cinéma, à table avec des adultes : c’est le même personnage, dans un environnement et avec des interlocuteurs chaque fois différents, qui prononce les phrases.
1re légende : Je ne peux pas voir cette fille.
2e légende : Je trouve ça affreux, mais la jupe n’est pas si mal.
3e légende : J’ai trouvé ça intéressant ; j’aime bien les films d’aventure.
4e légende : Cette mousse au chocolat est un délice !
Réfléchissons
1. Quels sentiments exprime chaque phrase ?
2. Ces phrases sont-elles prononcées par des personnes différentes ?
3. Dans chaque vignette, quel rapport existe-t-il entre les interlocuteurs ?
4. Quelles formules appartiennent — à la langue familière ? — à la langue courante ? — au langage soutenu ?
5. Emploie-t-on indifféremment les mêmes formules pour un objet, une personne, la nourriture ?
Leçon
Comment exprimer son contentement
Bravo ! Chouette ! Super ! Génial !
Je suis content (e) ; je suis heureux (se) ; je suis enchanté (e) ; je suis ravi (e) ; je suis satisfait (e) ; je suis fou (folle de joie)
Ça me plaît ; ça me ravit ; c’est très bien ; c’est parfait ; c’est formidable ; c’est épatant ; c’est extraordinaire ; c’est fantastique ; c’est stupéfiant ; c’est colossal ; c’est remarquable ; c’est fabuleux.
Comment exprimer son mécontentement
Je suis agacé (e) ; je suis ennuyé (e) ; je suis fâché (e) ; je suis en colère ; je suis furieux (se) ; je suis furibond (e) ; je suis furibard (e)
Je ne suis pas content (e) du tout ; je ne peux pas voir ça.
Ça m’ennuie ; ça m’agace ; ça m’énerve ; ça me casse les pieds.
Comment dire qu’on aime ou qu’on n’aime pas
la nourriture ______________________
c’est délicieux, très bon, succulent, pas très bon, mauvais, dégoûtant
;
je le (la) déteste
Je ne peux pas le (la) voir, le (la) sentir
Il (elle) ne me plaît pas du tout
|
un film, un livre, un spectacle |
un objet |
une personne |
une personne |
|
J’ai beaucoup aimé Ça m’a beaucoup plu |
Je trouve ça formidable, pas mal, (très) beau |
Elle (il) est très belle (beau) |
Elle me plaît énormément, elle est très bien, sensationnelle, merveilleuse, formidable, très sympa. |
|
|
|
|
|
|
Je n’ai pas aimé |
je n’aime pas beaucoup, pas tellement, pas du tout |
Elle (il) n’est pas très belle (beau), terrible. |
Il (elle) n’est pas sympa, pas très chouette, assez désagréable, ennuyeux (se) barbant (e), rasoir, casse-pieds, très désagréable, méchant (e) |
Résumé
Dire que l’on aime ou que l’on n’aime pas, c’est s’exprimer en employant un vocabulaire qui correspond à la nature de ce que l’on apprécie (personne, objet, nourriture…) et un registre de langue adapté au récepteur et à la situation.
Exercices
1. Dites ce que vous aimez, ce que vous n’aimez pas dans le domaine de la nourriture,
— à un copain, à une amie de votre âge, à votre correspondant (e) étranger (e)
— au père ou à la mère de cet ami ou de ce correspondant
2. Dites ce que vous aimez, ce que vous n’aimez pas d’une personne de votre connaissance, à propos de son physique, puis de sa personnalité
— à un copain, à une amie de votre âge
— à votre tante Hélène, qui est professeur de français.
3. Vous avez vu un film, une émission de télévision, un concert, ou acheté une cassette de votre groupe préféré. Exprimez ce que vous avez aimé ou ce que vous n’avez pas aimé
— à un copain, à une amie de votre âge
— à votre tante Hélène…
Fiche publiée dans Grammaire et activités 6e, Nathan, 1996.
Fiche5 : Nuancer son avis
Observons
Imaginez la scène suivante
Père et fillette :
Plus qu’une semaine et tu vas enfin aller à l’école !
Les mêmes :
Tu te rends compte ! Tu vas apprendre les conjugaisons, les tables de multiplication !
Les mêmes :
Père : Tu ne trouves pas ça formidable ?
Fillette : Si, Papa, tu as raison, mais c’est tout de même un peu triste…
Les mêmes :
Fillette :… de quitter aussi brutalement toute une vie consacrée à l’ignorance.
Réfléchissons
1. Lequel des deux personnages donne une information ? Quelle est-elle ? Par quelles phrases s’exprime-t-elle ?
2. Quel jugement ce personnage porte-t-il sur l’événement ? de quelle manière (vocabulaire, structure de phrase) ?
3. La question posée est-elle une vraie question ou une question orientée ?
4. Quelle est la première réaction du second personnage ? Comment s’exprime-t-elle ?
5. De quelle manière la fillette présente-t-elle son avis sur l’événement ?
Leçon
Sur de nombreux sujets, il est parfois difficile d’avoir un avis net et définitif. D’une part, on ne peut nier que l’interlocuteur ait des raisons valables pour proposer son jugement. D’autre part, on désapprouve sa position.
Pour ne pas être soupçonné d’ignorance ou de mauvaise foi, il est bon de reconnaître que l’interlocuteur a raison sur certains points : c’est faire une concession.
Ensuite, certaines formules permettent de présenter son avis personnel : c’est faire une objection.
Comment présenter une concession
Oui, c’est vrai (courant)… — Certes oui (soutenu) — Bien sûr. — C’est juste/vrai — C’est indéniable/juste/incontestable — Effectivement — En effet — Parfaitement — Sans doute/peut-être — Soit — D’accord sur ce point — Tout à fait d’accord avec vous — Il faut bien l’admettre — Il est certain que/il est exact que/Il est vrai que…
Avec des verbes :
Je le sais — Je l’admets — Je le reconnais — J’en conviens — Je n’en doute pas — Je suis sûr que — Je veux bien — Je veux bien l’admettre — Admettons — Je ne peux pas dire le contraire — je dois l’avouer — Si vous voulez — Je ne le nie pas — Vous avez raison — Je crois que vous avez raison —
Comment présenter une objection
Oui mais — Pourtant — Cependant — Toutefois — Quand même — Néanmoins (soutenu) — N’empêche que — Ça n’empêche pas tout de même — Cela dit — Mais tout de même — Mais quand même — Bien que — Quoique — Il n’en reste pas moins que — Quoi qu’il en soit…
Comment marquer un désaccord
J’aurais préféré — Je ne vous cache pas que — Il se trouve que — J’en suis désolé — Je le regrette — Je n’en suis pas persuadé — J’en doute — Toujours est-il que — Malheureusement — De toute façon — Pas vraiment — Pas toujours — Pas tout — C’est critiquable — C’est contestable — Eventuellement — En principe.
Non — Si — C’est faux — Ce n’est pas vrai — Absolument pas — Pas du tout — Sûrement pas — En aucun cas — Jamais de la vie — Justement — Raison de plus — Vous plaisantez — Vous voulez rire
Expressions familières : N’importe quoi ! — Ça c’est la meilleure ! Ça ne va pas la tête !
Résumé
Concéder, c’est admettre que, sur certains points, l’interlocuteur a raison.
C’est savoir nuancer son jugement, mais pour mieux affirmer ses objections par la suite.
Exercices
Improvisez les scènes suivantes par groupes de deux.
1. Tes parents veulent t’inscrire dans un centre aéré pendant l’été. Présentez des objections après avoir faire quelques concessions.
2. Tu veux emmener un (e) ami (e) en vacances avec toi chez ta grand-mère, à la campagne. Tu présentes vos arguments. Tes parents font des objections.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 6e, Nathan, 1996.
Fiche6 : Poser un fait comme certain
Observation
Dialogue :
— En Belgique, la plupart des gens paient tout avec une carte à puce.
— T’es sûr (e) ?
— Absolument certain (e) ! C’est un porte-monnaie électronique qui se recharge même dans une cabine téléphonique.
—… (le même) On peut même payer une baguette de pain, ou une seule photocopie.
— Super !
— Il est certain que c’est l’avenir !
— Je suis convaincu (e) que ça simplifie la vie des gens.
— Ce qui est sûr, c’est que nous pourrons bientôt en faire autant.
Questions :
1. Quelles phrases présentent une information nouvelle pour l’interlocuteur ? De quelles informations s’agit-il ?
2. Quelles expressions présentent ces informations comme certaines ?
3. Quel est le mode et les temps des verbes ?
Leçon
Pour exprimer qu’un fait est certain
— les expressions
bien entendu, sans aucun doute, ce qui est sûr, c’est que…, c’est bien lui qui…
c’est certain, évident, ça va de soi, bien sûr, ça va sans dire, de source sûre.
niveau familier : c’est couru d’avance, ça ne va pas rater, ça ne fait pas un pli, c’est dans la poche, à tous les coups…
expressions imagées comme deux et deux font quatre, il n’y a pas l’ombre d’un doute, clair comme le jour, clair comme de l’eau de roche, ça saute aux yeux, c’est réglé comme papier à musique, être ferme sur ses arçons, mettre la main au feu, en avoir le cœur net.
— les adverbes
certes, certainement, assurément, évidemment, sans aucun doute…
— le mode indicatif
— le présent qui exprime une vérité générale : je constate qu’il est absent.
— le passé composé ou le passé simple accompagnés de toujours, souvent, jamais
— les tournures impersonnelles
il est (tout à fait) certain, sûr,
niveau soutenu : il est avéré, incontestable, hors de doute, évident, clair, incontestable que… il apparaît que… il va de soi que…, il va sans dire que… il faut se rendre à l’évidence…, il faut reconnaître…, il faut admettre que…
— les constructions
c’est certain…, c’est sûr, on ne peut pas nier que…, comme chacun (le) sait…, de toute évidence…, de fait…, c’est un fait que…, ça va sans dire…
Pour constater
Je constate, j’observe que, je vois que, je remarque que, je note, je remarque, je vois, j’observe que…
Pour exprimer une certitude personnelle (conviction)
Je suis certain, je suis sûr que…,
je ne doute pas que…, je suis convaincu que…, je suis persuadé que
J’ai la certitude, la conviction, l’assurance que… je n’en pense pas moins, j’en mets ma main au feu
Les formules d’insistance
Je le répète, je vous assure que…, je vous certifie que…
Pour exprimer l’impossibilité
Il est impossible… il est exclu que… il n’y a aucune chance pour que…
Exercices
1. Imaginez la situation de communication dans laquelle les faits suivants seront énoncés. Présentez ces faits comme certains :
En l’an 2020, chaque élève aura son ordinateur personnel.
Mon client est innocent de cette affaire.
Le tabac est responsable de la formation du cancer du poumon.
L’aide humanitaire se suffit pas en Afrique.
Les dauphins sont des animaux intelligents.
2. Jouez les situations suivantes et faites parler les personnages :
Un savant faisant une conférence sur les méfaits de la pollution atmosphérique.
Des policiers ont établi que le hold-up avait eu lieu à 13H17.
Un professeur encourage un élève, à la veille d’un examen.
Un astronome parle de la vie sur les planètes du système solaire.
Résumé
Quand il pose un fait comme certain, l’émetteur reconnaît l’existence de ce fait de manière extérieure et objective.
La certitude est en principe objective. Elle repose sur des preuves.
La conviction est plutôt une croyance intime, intérieure.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 5e, Nathan, 1997.
Fiche 7 : Présenter un fait comme possible
Observation
(Dialogue entre deux enfants, dans l’autobus)
— Dis Zoé, dans peu de temps, on aura des euros. J’arriverai jamais à m’y retrouver !
— Tu rigoles ! Moi, je suis déjà capable de compter en euros ce que j’aurai comme argent de poche.
— Oui, mais Papy et Mamie, peut-être bien qu’ils se tromperont ?
— Bah ! on les aidera, tous les deux.
— Oui. Ça pourra être chouette, les euros. On pourra faire ses courses sans problème dans toute l’Europe.
— Est-ce qu’on aura encore besoin d’apprendre à compter ?
— Ça ! Mystère !
Questions
1. De quelle information part le dialogue ?
2. Cette information est-elle présentée comme certaine ou non ? Justifiez votre réponse.
3. Quelle capacité Zoé se reconnaît-elle ?
4. Quels faits peuvent se produire sans être présentés comme certains ?
5. Quels mots et expressions sont employés pour présenter ces faits ?
Leçon
Présenter un fait qu’on peut accomplir
Je peux, je suis capable de, j’ai suffisamment d’aptitude pour, je suis à même, je suis en mesure de, je ferai tout ce que je pourrai, tout ce qui m’est possible, tout mon possible, tout ce qui est en mon pouvoir.
Présenter un fait comme possible
ça se peut que… peut-être bien que…, on peut,
il est possible que (subj)…, il n’est pas impossible que…, il n’est pas exclu que…, il se peut que…, il se pourrait bien que…, il serait…
on peut dire, penser, prévoir, estimer, que…
c’est peut-être…
selon certains bruits…
Expressions imagées du possible et de l’impossible :
être dans les cordes de, ce n’est pas la mer à boire ;
vouloir prendre la lune avec les dents, chercher midi à quatorze heures, chercher une aiguille dans une botte de foin, chercher à tondre un œuf, demander de la laine à un âne, demander la lune, c’est un nid de souris dans l’oreille d’un chat, ce sera la semaine des quatre jeudis, à l’impossible nul n’est tenu.
Exercices
1. Vous présenterez comme possibles les faits suivants :
Dans l’Antiquité, on connaissait déjà la chirgurgie esthétique.
L’Amérique a été découverte bien avant Christophe Colomb.
La médecine homéopathique guérit certaines maladies devant lesquelles la médecine moderne échoue.
Le télétravail sera généralisé en l’an 2020.
Léonard de Vinci avait inventé l’hélicoptère.
2. Que ferez-vous cette année pendant les grandes vacances ? Répondez en exprimant des possibilités.
3. M. Dubois est resté à Paris en août. Mme Dubois et les enfants sont à La Baule. Mme Dubois téléphone à son mari et lui explique ce qu’il peut faire pour assumer les travaux ménagers, varier ses repas et soigner les poissons rouges.
Retenons
On peut affirmer qu’un fait est possible quand ce fait peut se produire, compte tenu des moyens dont on dispose, des circonstances, des lois, des règles.
Pour présenter un fait comme possible, l’émetteur pose une action qu’il a le pouvoir physique ou intellectuel d’accomplir.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 5e, Nathan, 1997.
Fiche 8 : Poser un fait comme probable
Observation
— Alexis n’a pas téléphoné ? Il avait un entretien d’embauche cet après midi.
— Non, il n’a pas appelé. Je crois bien qu’il a échoué.
— Il a dû passer un mauvais moment.
— A mon avis, il n’a pas encore fini.
— Il doit avoir oublié sa carte téléphonique.
— Il se peut qu’il ait réussi et qu’il fête ça avec ses copains.
— Il est probable qu’il reviendra par le train de 8H.
«
1. De quel fait part le dialogue ? Ce fait est-il certain ou non ?
2. Les explications données à ce fait sont-elles absolument certaines ?
3. Distinguez dans chaque phrase les mots et tournures qui l’indiquent.
4. Quels sentiments peuvent éprouver chacun des interlocuteurs, selon vous ?
Leçon
Présenter un fait comme probable :
— les verbes : sembler, avoir l’air… donner l’impression de…, devoir + infinitif (il doit être malheureux)
— les constructions impersonnelles
il paraît… il semble que… semble-t-il… à ce qu’il semble…
il semble bien que, il est probable que, il est vraisemblable que (+ indicatif ou subjonctif selon l’intention de l’émetteur), il y a des chances, il y a de fortes chances pour que (+ subjonctif)
— les adverbes
presque, à peu près, sans doute
probablement, vraisemblablement, apparemment
— le conditionnel
on dirait…, dirait-on…, (un concurrent de la course aurait fait naufrage)
— le futur antérieur
il aura… , il sera … (il aura été retardé, il sera arrivé en retard)
— certaines expressions
à mon avis…, à vue de nez…, en gros…, c’est du moins l’impression que…,
faire (il fait jeune)
Présenter un fait comme improbable
Il ne semble pas que… il est improbable que…, il est invraisemblable que…, il est (bien) peu probable que… il est (bien) peu vraisemblable que (+ subjonctif)
il y a (bien) peu de chances pour que…
Exercices
1. Présentez les faits suivants comme probables, en faisant varier les moyens d’expression :
Nous aurons de la pluie cette fin de semaine.
Le nouveau ministre fera une réforme.
Les handicapés communiquent grâce à un synthétiseur vocal.
L’entraîneur sélectionne les joueurs en fonction des attaquants.
On trouvera un vaccin contre le sida.
L’accès à Internet sera réglementé.
Le bac sera supprimé.
2. Présentez les faits suivants comme improbables :
Le PSG descend en deuxième division.
Les sportifs de haut niveau ne se dopent plus.
La vente des armes est interdite aux Etats-Unis.
Les extra-terrestres existent.
Mon père cesse de fumer.
Les déserts deviendront cultivables.
On se nourrira de comprimés.
La majorité sera fixée à quinze ans.
3. Mettez en relation les deux faits suivants en exprimant que l’un a probablement entraîné l’autre :
Tu ne joues pas aussi bien que d’habitude. Tu es fatigué.
Tu ne te soignes pas. Ta grippe se complique en bronchite.
Il cherche partout. Il a oublié ses clefs de voiture.
Ma petite cousine a grandi pendant les vacances. Elle a fait une cure de vitamines.
La voiture ne démarre pas. Les bougies sont à changer.
4. Vous êtes détective. Après le cambriolage d’une villa, vous faites des déductions, en variant les degrés de probabilité (peu probable, probable, fort probable), à partir des faits suivants :
— Il y a des traces de pas dans le jardin.
— Les empreintes digitales ont été effacées.
— Le système d’alarme a été débranché.
— Seul le bureau a été fouillé.
— Il y a des traces de brûlé sur la moquette.
— Les domestiques étaient en congé ce soir-là.
— Les propriétaires s’absentent souvent.
— Les propriétaires sont en instance de divorce.
— Le propriétaire affirme que le coffre-fort a été vidé.
Retenons
Un fait probable est un fait qui, sans être absolument certain, peut ou doit être tenu pour vrai plutôt que pour faux.
Quand il présente un fait comme probable, l’émetteur envisage un fait qui fait l’objet d’un calcul et il se prononce sur la vraisemblance de son apparition.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 5e, Nathan, 1997.
Fiche 9 : Exprimer une obligation
Observation
— Il y a longtemps que je ne t’ai pas vu.
— La date du bac approche, je suis pris à la gorge. Je dois réviser mes maths.
(Plus tard, les parents…)
— Tu dois absolument réviser tes cours.
— Oui, bof.
— Tu n’y coupes pas : je t’interdis de sortir jusqu’à fin juin.
(Plus tard, ailleurs, d’autres)
— Non, je n’ai pas aperçu Grégory, il devait être en train de travailler pour son examen
Questions
1. Quelles phrases expriment une obligation extérieure (il est obligé de, contraint de…) ?
2. Quelle phrase exprime une obligation intérieure (il est moralement obligé de) ?
3. Quelle phrase exprime une probabilité (sans doute) ?
4. Quel verbe, et à quel temps, exprime tantôt l’obligation tantôt la probabilité ?
Leçon
Pour exprimer l’obligation :
— des tournures impersonnelles
Il faut, il est nécessaire de, il est obligatoire de…, il me faut
— des phrases nominales
défense de fumer ; interdiction de chasser ; pêche interdite ; port du casque obligatoire ;
— des tournures verbales
le champagne se boit frappé
L’obligation interne (morale)
je dois, mon devoir est de…, j’ai le devoir de…, j’ai à…, je suis tenu de…, je suis censé…, je suis chargé de…, je ne peux pas ne pas…, je me dois de…
l’obligation externe (contrainte)
Il m’a demandé de…, ordonné de…, donné l’ordre de…, dit de…,
Expressions imagées de la contrainte :
être sous la férule de, être à la merci de, tomber dans les mains de quelqu’un, être tenu de, être pris à la gorge, tomber sous la coupe de, baisser la lance devant quelqu’un, ne pas y couper, mettre les pouces, avoir bon dos, marche ou crève, taillable et corvéable à merci ;
faire sauter le bâton, faire chanter, prendre à la gorge, mettre en demeure, arracher une dent à quelqu’un, forcer la main, mettre au pied du mur, faire avaler la pilule, mettre au pas, faire marcher au pas, serrer la vis.
Pour exprimer l’obligation
Il est interdit de, défendu de…, il ne faut pas…, on n’a pas le droit de…,
Défense de…,
Je ne peux pas…, je ne dois pas…, je suis tenu de ne pas…, je suis censé ne pas…
Il m’a interdit de, défendu de…, il s’oppose à ce que je fasse
Je ne peux pas me permettre de…, je me défens de…, il ne m’appartient pas de…, je n’ai pas à…, ce n’est pas à moi de…
Exercices
1. Exprimez l’obligation pour les faits suivants :
La vaccination contre l’hépatite B.
L’entraînement quotidien des athlètes.
Le développement de la recherche médicale.
Le contrôle technique des voitures.
2. Classez les faits suivants selon qu’ils expriment une obligation interne ou une obligation externe :
Il faut manger pour vivre
Il faut augmenter les salaires.
Appeler le SAMU.
Se laver les dents chaque soir.
Remercier d’une invitation.
Ne pas dire de gros mots.
Ne pas se doper.
Se soumettre au contrôle antidopage.
Céder sa place dans l’autobus.
Juger les crimes contre l’humanité.
Dénoncer un racket.
Rendre ce qu’on a emprunté.
3. Improvisez les scènes suivantes en exprimant l’obligation :
• Par téléphone, vous donnez à un copain des instructions pour imprimer un fichier sur un P.C.
• Vous essayez de réconcilier Anne et Marc, qui sont fâchés à mort. Vous vous adressez alternativement à l’un et à l’autre.
• La mère de Youssef à son fils quand elle voit l’état de la maison après sa soirée d’anniversaire.
• Vous prenez la parole au conseil municipal des enfants et vous réclamez des améliorations pour le quartier (rue piétonne, crèche, rues mieux éclairées, tri des déchets, plantations, maison de quartier pour les jeunes, animations…)
• Vous faites un plaidoyer pour obtenir la majorité à quinze ans en insistant sur les droits et devoirs du citoyen.
Résumé
L’obligation pose une action à faire dont la réalisation dépend de celui qui parle.
L’émetteur dit qu’il doit accomplir cette action
— soit parce qu’il se donne l’ordre à lui-même (obligation interne)
— soit sous la pression d’une autorité (obligation externe).
Fiche publiée dans Grammaire et activités 5e, Nathan, 1997.
***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Fiche 10 : Insister
Observation
(Dialogue entre un producteur et un metteur en scène)
— Il nous faut une rallonge de six mois pour le film.
— Non ! Tu n’arrêtes pas de dépasser les délais.
— Tu sais bien tout de même qu’on ne pouvait pas prévoir qu’Armelle Armani se casserait la jambe.
— Sache-le bien : tu n’auras pas un jour de plus.
— Encore une fois, je te le répète, on ne pourra jamais finir le film dans ces conditions.
— Rien à faire.
— Sois-en persuadé : nous tournons l’œuvre du siècle. Donne-moi du temps et tu seras aussi célèbre que David O. Selznick !
Questions
1. De quelle fait part la conversation ?
2. Que demande le metteur en scène ? Que répond le producteur ?
3. Comment les interlocuteurs s’y prennent-ils pour insister sur leurs propos ?
4. Quels mots et expressions expriment cette insistance ?
Leçon
Pour insister
Parole…, sans blague…, n’empêche…, allez, tenez…
vraiment…, franchement…,
je dis…, je déclare…, j’affirme que…, (ceci), je l’affirme… je le dis sans hésiter… je le dis bien haut…
je t’assure…, je te garantis que…
tu sais bien tout de même, quand même…
j’attire ton attention sur le fait que…, je dis bien que…, je souligne que…, j’insiste sur le fait que…
sache-le bien…, encore une fois je te le répète…, sois-en persuadé…
Tu n’ignores quand même pas, tout de même pas…
dans les documentaires, les exposés :
il ne faut pas oublier que… il faut tenir compte que…, du fait que…, il faut bien noter que… il faut savoir que…
on notera que… on ne saurait manquer de relever que…
cela fait (bien) voir — ressortir — que…
c’est digne d’attention…
c’est un point important, essentiel…
Pour insister en ajoutant une certitude :
il est évident, sûr, certain que…
assurément… évidemment (évidemment, je lui ai dit…, que je lui ai dit…
bien sûr…
Pour insister en ajoutant une conviction personnelle :
je suis persuadé que…, je suis convaincu…, sûr que… (etc)
Quand on a dit quelque chose que l’interlocuteur ne croit pas :
Mais je t’assure, je te jure, je te garantis, je te redis que c’est vrai…
Sans blague…, non mais sans blague !
Insister sur une réponse négative :
Non, vraiment, c’est non !…, j’ai déjà dit non !…, n’insistez pas, c’est inutile…, quand je dis non, c’est non,… ce n’est pas la peine d’insister…, inutile d’insister, c’est toujours non.
expressions imagées :
pousser à la roue, en faire un cheval de bataille, mettre les points sur les i, faire un sort à, appuyer sur la chanterelle, monter en épingle, enfoncer le clou, faire fort, en faire un plat, par-dessus le marché.
Exercices
Improvisez les scènes suivantes, en utilisant des formules d’insistance variées
1. Votre nouvel appareil photo, bourré d’électronique, est tombé en panne après deux jours d’utilisation. Au service après-vente, vous insistez pour qu’on vous l’échange.
2. Vous avez enfin décroché une audition auprès du directeur artistique d’une grande maison de disque. Vous lui présentez vos dernières compositions musicales.
3. Personne ne veut vous aider à faire un journal au collège. Vous demandez de l’aide à un professeur, à un surveillant, au principal, aux élèves de 3e.
4. En l’absence de vos parents, vous êtes chargé de surveiller le petit frère. Celui-ci ne veut pas prendre son bain, aller se coucher ; il veut se nourrir de cacahuètes et de ketchup. Vous insistez pour qu’il soit raisonnable.
5. Vous allez passer un moment chez un copain, qui veut vous faire écouter une musique que vous n’aimez pas. La discussion s’engage sur le rap, le raï, la techno, le funk, l’acid, le hard-rock…
6. Dialogue au restaurant. Vous vouliez votre hamburger saignant, on vous l’apporte archi-cuit. Vous refusez en insistant. Improvisez successivement la scène sur le ton humoristique, compréhensif, sérieux, à la limite de la colère, etc.
7. Vous habitez un appartement en ville, et malgré cela, vous voulez adopter un braque allemand, un doberman, un saint-bernard, un labrador ou un setter irlandais. Improvisez le dialogue avec vos parents.
8. Vous trouvez un petit enfant perdu dans un supermarché. Vous insistez pour qu’il vous dise son nom, puis vous l’emmenez au service d’accueil et vous demandez qu’on s’occupe de lui en priorité.
Résumé
Insister,
c’est s’arrêter avec force sur un point particulier, mettre l’accent sur quelque chose.
On peut insister sur l’acte de parole lui-même (je le dis et le redis) ou sur un fait (j’insiste sur le fait que…).
On peut insister en ajoutant une certitude, une conviction personnelle.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 5e, Nathan, 1997.
************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Fiche 11 : Faire des hypothèses
Observation
(Dialogue entre supporteurs pendant un match de foot.)
— Si le P.S.G perd encore le championnat de France, va y avoir des bouleversements dans l’équipe.
— Oui, c’est sûr. Mais si Monaco perd, l’A.J. Auxerre va décoller de sa septième place.
— Hum ! Y n’ont pas eu de chance. Si le calendrier de la ligue des champions avait pas été pourri, y aurait eu moins de joueurs blessés !
— Ouais, peut-être. Mais ça va changer. Si les vedettes de Guy Roux reviennent en championnat, la fin de saison s’ra peut-être plus excitante.
— Ça, on en a vraiment besoin.
— Sûr !
Questions
1. Imaginez l’endroit où se trouvent les interlocuteurs, et à quel match ils assistent.
2. Le match n’étant pas terminé, quelles suppositions font-ils sur le présent ?
3. Quelle hypothèse font-ils sur ce qui s’est passé précédemment ?
4. Quelle hypothèse font-ils sur le futur ?
5. Par quels mots et expressions expriment-ils leurs hypothèses ?
Leçon
Pour faire l’hypothèse qu’un fait est vrai
Suppose que…, je suppose… supposons… supposez…
j’imagine… imaginons…, imaginez…
j’admets…, admettons…, admettez…
je pose que…, posons que…
je me demande si…
Il se peut que… (+ subjonctif)
on dit que tu serais…, est-ce que vous ne seriez pas… ?
soit un triangle…
il aurait plu…, il pleuvrait…
Pour faire une hypothèse dans le présent
s’il a plu, il n’est pas sorti ; au cas où…, en supposant que…
s’il pleut…
s’il pleuvait…
dans l’hypothèse où…
Pour faire une hypothèse dans le passé
il a encore dû…
s’il avait plu…, à supposer qu’il ait plu…
en supposant qu’il ait plu…
au cas où il aurait plu…
s’il pleuvait, tu sortirais ?
Exercices
A. Imaginez les situations dans lesquelles les phrases suivantes ont été prononcées :
— Je ne l’ai pas vu cet appartement, mais je suppose que la cuisine est minuscule.
— Il a encore dû s’endormir dans le TGV.
— Supposons que AB et CD soient égaux…
— Vous ne seriez pas en train de chercher vos lunettes ?
— Tes copains seraient peut-être heureux de pouvoir passer de temps en temps.
B. Ils font des hypothèses. Imaginez leur conversation :
1. Gaëlle et Estelle roulent sur l’autoroute. Soudain, la voiture ralentit sans raison. Le moteur fait un bruit anormal.
2. Juste au moment où l’on ferme la maison à clé pour partir en vacances, la petite se plaint à ses parents d’avoir très mal au ventre.
3. Jean et Véronique sont invités à dîner ce soir chez Bernard et Sophie. Quand ils arrivent devant la maison, le portail est fermé, tout est éteint, il n’y a aucun signe de vie…
4. Vous êtes dans le métro. Vous avez juste une demi-heure pour aller de la gare du Nord à la gare de Lyon. Soudain la rame s’arrête entre deux stations…
5. Des gens emménagent dans l’appartement qui est juste en face du vôtre sur le palier. Vous faites des suppositions sur leur identité, sur vos futures relations.
6. Vous répondez à votre correspondante qui vous écrit : « A treize ans, je suis plutôt mignonne, mais j’ai un gros problème : les garçons de ma classe ne me regardent pas, ne me parlent jamais. De plus, j’ai toujours peur de gaffer. Qu’est-ce que je dois faire ? »
7. Votre meilleur copain a envie de changer de look : coupe de cheveux, vêtements, piercing. Ensemble, vous faites des hypothèses sur les réactions de l’entourage.
C. Que feraient-ils s’ils vivaient aujourd’hui :
Jeanne d’Arc — Pasteur — Mozart — le docteur Schweitzer
D. Vous êtes journaliste à la télévision. Vous devez faire un flash spécial sur la nouvelle suivante :
Un vol de bijoux particulièrement audacieux a été commis à l’encontre d’un grand joaillier parisien. Les voleurs ont payé les bijoux avec des faux dollars émanant d’Euro Disney et portant la mention « Mickey vous remercie ». L’enquête ne fait que commencer, et on ne sait pas comment les voleurs s’y sont pris.
Résumé
Faire une hypothèse, c’est admettre provisoirement l’existence d’un fait, avant de le vérifier ou de le démontrer.
Faire une supposition, c’est émettre une hypothèse considérée comme provisoirement juste et qui sert de point de départ à un raisonnement.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 5e, Nathan, 1997.
***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Fiche 12 : Persuader
Observons
Une conversation entre deux sœurs
a) L’aînée
Samia, j’ai vu un pull super en vitrine, à 15 euros
b) La même
La couleur t’irait bien à toi aussi. Nous avons la même taille.
c) la même
Je pourrais te le prêter pour la soirée de Noémie. Tu serais la star !
d) la même
Peux-tu me prêter 10 euros pour l’acheter ?
Réfléchissons
1. Qu’est-ce que la sœur aînée veut obtenir de la cadette ?
2. Présente-t-elle cette demande d’emblée ? Pourquoi ?
3. Que veut-elle suggérer d’abord ?
4. Quels sentiments veut-elle faire naître chez la cadette ?
Leçon
Pour obtenir quelque chose de quelqu’un, on peut soit lui donner des ordres, soit le persuader. Chaque fois que c’est possible, il vaut mieux persuader qu’ordonner : quand on cherche à persuader, on marque son respect pour l’interlocuteur, on lui laisse la liberté de changer d’avis ou non.
Pour réussir à persuader, il faut ne jamais perdre de vue le but à atteindre.
Pour faire admettre ce but, on utilise de bonnes raisons que l’on communique à son interlocuteur.
Ces raisons, ou arguments, n’ont pas besoin d’être très nombreuses. En revanche, il faut savoir les choisir de façon qu’ils soient bien adaptés au destinataire.
Vous savez également par expérience que le moment de la persuasion doit être bien choisi : ce n’est pas spécialement au moment où votre mère commence une mayonnaise que vous devez l’entreprendre sur un sujet délicat.
Un argument bien choisi peut s’adresser au bon sens, à la logique, à l’intelligence de l’interlocuteur. On dit alors que l’on cherche à le convaincre.
Pour persuader quelqu’un, on cherche à l’émouvoir, à « jouer sur la corde sensible », à insister sur ce qui le touche le plus, à le séduire comme le fait la publicité, à utiliser ses points faibles.
Pour suggérer
Et si tu faisais… ? — Je te propose de… — Est-ce que tu pourrais… ? — Est-ce que tu ne pourrais pas… ? — Ne pourriez-vous pas… ? — Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas… ? — On pourrait essayer de…
Pour demander un service
Je te serais très reconnaissant si tu pouvais — Ça te dérangerait beaucoup de… ? Tu serais gentil de… — Ce serait gentil de ta part si tu pouvais… — S’il te plaît, peux-tu… ? — Est-ce que je peux te demander quelque chose ? — Est-ce que tu pourrais me rendre un petit service ?
Pour prier
Essaie de… — Sois gentil… — Tâche de… — Pourquoi ne pas… — Si possible… —
Exercices
Qui et en quelle circonstance a pu prononcer les phrases suivantes :
1. Dis, si je suis bien sage, tu me laisseras jouer avec ton ordinateur ?
2. Me ferez-vous la grâce d’accepter ce modeste témoignage de ma reconnaissance ?
3. Monsieur, puis-je me permettre de solliciter une minute de votre attention ?
4. Sois gentil, ne crie pas, je ne l’ai pas fait exprès !
5. Ne me laisse pas longtemps sans nouvelles, téléphone-moi vite, je te prie.
6. Laissez-moi voir le docteur, je vous en prie, c’est très grave.
Pour insister
Je vous assure que… — Je vous jure que… — Je vous garantis que… — Vous n’avez qu’à… — Il n’y a qu’à… — Vous auriez tort… — Ce serait bête de…
Pour mettre en garde
À ta place, je ferais — Tu ne devrais pas — Attention, je te préviens que… — N’oublie pas que… — Je pense que tu devrais te souvenir que… — Mets-toi à ma place… — Il vaudrait mieux que tu… — Si j’avais un conseil à te donner — Je te recommande fortement de… — Vous feriez bien… — J’aimerais vous mettre en garde contre… — Permettez-moi d’attirer votre attention sur… — Un homme averti en vaut deux (proverbe)
Résumé
Persuader, c’est amener quelqu’un à changer d’avis, à faire ce que l’on désire qu’il fasse, à penser ce que l’on souhaite qu’il pense.
On persuade en s’adressant surtout aux sentiments
Exercices
1. Vous voulez persuader vos parents de vous emmener un dimanche à Euro-Disney.
2. L’hôtel ou le camping est interdit aux chiens. Vous voulez persuader la réceptionniste qu’il est indispensable de laisser séjourner Bob, votre berger des Pyrénées si gentil…
3. Tu as besoin d’argent, et tu voudrais vendre un objet personnel à un copain : vêtement, cassette, dvdr, sac à dos, baladeur…
4. Un de vos copains arrive le soir à la maison pour passer un moment. Vous aimeriez qu’il parte parce que vous avez d’autres projets pour la soirée.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 6e, Nathan, 1996.
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Fiche 13 : Convaincre
Observons
Une classe avec un professeur et un (plusieurs) élève (s)
a) Madame, pour jeudi on a un contrôle de maths et un contrôle d’anglais.
Les mêmes
b) Pour nous, c’est important. On est presque tous en danger de mort.
Les mêmes
c) La rédaction que vous demandez risque d’être bâclée.
Les mêmes
d) Elle serait meilleure si on la rendait lundi !
Réfléchissons
1. Quel est le problème des élèves ?
2. Que désirent-ils obtenir du professeur de français ?
3. Quels arguments les élèves ont-ils choisi ?
4. Ces raisons s’adressent-elles à la raison ou aux sentiments ? Justifiez votre réponse.
Leçon
Ordonner ou convaincre
Quand on donne un ordre, on montre à son interlocuteur que l’on exerce un certain pouvoir sur lui. Une mère peut ordonner à son fils de ranger sa chambre ou de se changer, un professeur doit donner des exercices, des rédactions…
Cependant, au lieu d’imposer la lecture d’un roman, un professeur expérimenté préférera vous donner des raisons de lire ce livre en le présentant de façon habile et en vous demandant votre avis sur cette lecture. Vous aurez ainsi davantage de motivation, et vous y prendrez plus d’intérêt et de plaisir.
Convaincre est une démarche qui respecte l’interlocuteur en lui laissant la liberté de sa décision finale. Cette démarche demande un certain savoir-faire.
Il est d’abord indispensable de ne jamais oublier, dans la conversation, la conclusion à laquelle on souhaite parvenir.
Il s’agit ensuite de bien choisir un certain nombre d’arguments, adaptés à la situation et à la personne que l’on désire convaincre.
Si l’on s’adresse plutôt à la sensibilité, aux émotions de l’interlocuteur, on choisit de le persuader.
Si l’on désire plutôt faire appel à son bon sens, à son sens de logique, à ses capacités de raisonnement, on choisit de le convaincre.
Pour exprimer une certitude
Il est certain… — Il est incontestable/indiscutable que… — Il est établi que… — Il est prouvé que… — Il est démontré que… — Ce qui est sûr, c’est que… — C’est bien cela qui… —
Je suis sûr/certain que… — Je ne doute pas que… — Nous avons la certitude que… — Je suis convaincu que… — Je le répète… — Je vous assure que… — Je vous certifie que…
Exercice
Vous devez passer une petite annonce pour vendre une moto d’occasion. Comme le nombre de lignes de l’annonce est limité, choisissez quatre arguments dans la liste suivante :
Faible consommation
Prix intéressant
Modèle récent
Antivol et casque
Faible kilométrage
Selle confortable
Amortisseurs en bon état
Papiers en règle
Tenue de route irréprochable
Modèle récent
Entretien régulier.
Comment convaincre l’interlocuteur
— en faisant appel à sa raison
Vous croyez vraiment que… — Vous pensez réellement que… — Vous ne pensez pas que… — Vous ne croyez pas que…
— en lui rappelant certains faits
Vous savez bien que… — Vous n’ignorez pas que… — Tout le monde sait bien que… — Vous savez quand même/tout de même… — Vous n’ignorez quand même pas…
— en attirant son attention
Je puis vous dire ceci… — Écoutez-moi bien — Je vais vous dire une chose.
— en insistant
Sachez-le bien… — Soyez-en persuadé… — Encore une fois, je vous le répète…
— en citant une personne « savante » ou célèbre
Le Président pense que… — Les médecins disent que… — Le médecin considère… — L’abbé Pierre disait que…
Résumé
Convaincre quelqu’un, c’est amener quelqu’un à changer d’avis, à faire ce que l’on désire qu’il fasse, à penser ce que l’on souhaite qu’il pense.
On cherche à convaincre en s’adressant surtout à l’intelligence, au raisonnement intellectuel.
Exercices
Improvisez les scènes suivantes par groupes de deux.
1. Voici le contrôleur. Malgré de fébriles recherches dans toutes vos poches, vous ne retrouvez plus votre ticket d’autobus. Essayez de le convaincre de votre honnêteté et de votre bonne foi.
2. Vous voulez échanger un vêtement trop grand ou trop petit dans un magasin, mais vous avez perdu le ticket de caisse. Essayez de convaincre la vendeuse qui vous refuse tout d’abord l’échange.
3. Votre vélo tout terrain est en panne. « Pas avant huit jours ! » vous dit le réparateur. Or, vous avez prévu une sortie avec les copains pendant le week-end. Présentez vos arguments et prévoyez les objections que l’interlocuteur va vous opposer.
4. Le manomètre de la chaudière de chauffage central marque le zéro. En l’absence de vos parents, vous devez convaincre le chauffagiste de se déplacer d’urgence.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 6e, Nathan, 1996.
Fiche 14 : Valoriser, minimiser une information
Observons
Dans un laboratoire futuriste
L’ingénieur. — Nous avons fabriqué un robot entièrement nouveau. C’est un ordinateur qui s’autoprogramme.
Le Ministre de la Défense. — C’est une découverte prodigieuse ! Comment avez-vous fait ?
L’ingénieur. — Nous avons interconnecté des milliards de microprocesseurs.
Le Ministre de la Défense. — Cette invention a des conséquences incalculables. Nous sommes placés devant un choix capital.
Le chef des services secrets. — Certes, mais il n’en reste pas moins qu’il faudra toujours des hommes pour le fabriquer.
Le Ministre de la Défense. — Quand pourrons-nous le mettre en service ?
L’ingénieur. — Bientôt. Il reste à lui donner une forme. Celle d’un homme ou celle d’une femme ?
Questions
1. De quelle information part le dialogue ? Qui a une opinion favorable du fait évoqué ? Qui émet des réserves ?
2. Par quel moyens la découverte est-elle valorisée ? Citez les mots et expressions et identifiez-les.
3. Par quel moyen l’information est-elle minimisée ? Connaissez-vous d’autres moyens de le faire ?
Leçon
1. Valoriser une information
On peut utiliser :
une expression hyperbolique :
l’affaire du siècle — la voiture de l’année — le procès du siècle — une prouesse — un tour de force — un exploit — une performance — un record — un chef-d’œuvre — un atout-maître — une carte maîtresse…
de nombreux adjectifs :
Un projet gigantesque — une joie infinie — une portée incalculable — une conséquence immense — un voyage fabuleux — une femme sublime — un homme extraordinaire — des qualités évidentes — un événement prodigieux…
un adjectif marqué d’un degré de comparaison ou d’intensité :
l’une des plus grandes prouesses techniques — l’événement le plus considérable — le train le plus rapide du monde
une construction négative qui équivaut à une affirmation :
des qualités sur lesquelles il est inutile d’insister — sur lesquelles il n’est pas utile de s’étendre…
2. Minimiser une information
Exercices
1. Présentez l’application informatique qui transcrit les paroles en orthographe correcte et les traduit en cinq langues. Valorisez le produit.
2. Vous présentez un événement sportif, un record, une découverte scientifique en valorisant l’exploit.
3. Présentez une publicité pour un appareil ou un produit de votre choix, réel ou imaginaire.
4. Certains adultes affirment que les jeunes ne s’intéressent plus à rien. Pour les contredire, présentez un ou plusieurs sujets qui vous passionnent. Présentez-les en les valorisant.
5. Valorisez, au choix, une des informations suivantes :
— Le nombre de crimes de sang dans la population française n’a pas augmenté depuis 1960.
— On diminue le temps de travail hebdomadaire dans les écoles.
— Pavel Vinogradov a réussi à réparer la station MIR en août 1997.
— La Convention internationale des droits de l’enfant a été signée en novembre 1989.
— Des associations lancent une campagne contre le bizutage.
6. Minimisez une des informations suivantes :
— Un groupe de médecins annonce qu’un malade a reçu un foie électronique.
— On a recueilli plusieurs témoignages sur les OVNI.
— Les jeunes de 4 à 14 ans passent en moyenne 109 minutes par jour devant la télévision.
— Le ministre s’inquiète du retard de la France en informatique.
Retenons
Pour valoriser un fait ou un événement, on peut combiner plusieurs moyens : emploi d’une expression hyperbolique, d’adjectifs valorisants, d’adjectifs marqués par un degré de comparaison ou d’intensité, emploi d’une formule négative à valeur positive.
Pour minimiser un fait ou un événement, on utilise un certain nombre de formules qui permettent d’admettre un fait à un niveau particulier mais de le refuser au plan général, de prendre l’interlocuteur à témoin, de proposer un contre-exemple, de déplacer l’objet du problème.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 4e, Nathan, 1998.
Fiche 15 : Prendre des distances, prendre des précautions
Observation
(Conversation à la sortie du cinéma entre Ernest-Antoine et Katherine. Ils viennent de voir BATMAN)
E.A. — Ce film est très mauvais, il est encore plus infantile que la BD.
K. — Difficile à dire. Certains assurent qu’il est aussi intéressant.
E.A. — Le héros est ennuyeux. Rien de bon, à part de costume.
K. — Il ne faut pas exagérer.
E.A. — Le scénario est totalement inexistant.
K. — On ne peut pas vraiment dire ça.
E.A. — L’acteur en fait des tonnes. Cette batmania délirante, c’est nul !
K. — Sans doute, mais il y a peut-être une autre manière de voir les choses : d’après les critiques, le héros devient très émouvant à la fin.
Questions
1. Katherine est-elle du même avis qu’Ernest-Antoine sur le film ?
2. Comment Katherine s’y prend-elle pour éviter de le contredire et de le vexer ?
3. Comment Katherine présente-t-elle des paroles qui contredisent l’avis d’Ernest-Antoine ?
Leçon
Pour ne pas s’engager :
Ah, oui, vraiment ?
Allez savoir !
Ce n’est pas vraiment mon domaine.
Ce n’est peut-être pas si simple.
Certainement. Sans doute. Peut-être.
Difficile à dire, difficile de juger.
Il ne faut pas exagérer. N’exagérons rien
Il y a tellement à faire !
Laissez-moi réfléchir.
Pardon ?
Si, si, bien sûr !
Tu crois ? Vous croyez ?
Vous pensez vraiment ce que vous dites ?
Voyons, voyons !
Pour ne pas blesser par un refus :
Ce n’est pas à moi qu’il faut demander ça.
Excusez-moi, mais il faut que j’en parle à ma femme, à mon mari, à mes enfants.
Il faut que j’en parle à mes collègues.
Il faut que je demande l’autorisation de mes parents
J’aimerais bien, mais je ne peux pas.
Je n’y connais vraiment rien.
Je ne peux pas vous répondre maintenant.
Je vais voir.
Je vais y penser.
Je vais y réfléchir.
Laissez-moi le temps de réfléchir.
Pour attribuer à quelqu’un des paroles dont on lui laisse la responsabilité :
• Citer ses sources
À leur avis,
Aux dires de l’auteur,
D’après les organisateurs,
Selon l’auteur,
Si l’on en croit les sondages.
Si l’on en croit les témoins,
Suivant la gardienne de l’immeuble…
• En soulignant par l’intonation ou une expression rituelle que vous citez les paroles de quelqu’un :
C’est soi disant un accident.
C’est un accident, le commissaire dixit,
C’est, je cite, un « accident »
• En choisissant des verbes introducteurs qui marquent
— que vous ne croyez guère à ce qui a été dit ;
— que vous répétez les paroles avec prudence : soutenir, maintenir, avancer, prétendre, certifier, jurer…
• En utilisant le conditionnel et la plupart des marques du point de vue de l’émetteur :
Les scientifiques affirmeraient que… Il est possible que… Il est probable que…
Exercices
1. Vous voyagez en train et votre voisin(e) vous pose des questions indiscrètes. Vous répondez évasivement.
2. Vous êtes dans un taxi. La voiture est bloquée par une manifestation. Le chauffeur commence à donner son opinion sur la situation. Vous, vous ne voulez pas engager la discussion.
3. Un vendeur d’encyclopédie frappe à votre porte. Vous l’éconduisez poliment sans le heurter de front.
4. Vous entrez dans un magasin de vêtements. Immédiatement, la vendeuse vous propose de vous conseiller. Vous voudriez choisir en paix, sans être impoli (e).
5. Votre meilleur (e) copain (amie) vient d’adhérer à une association qui vous paraît un peu bizarre. Elle veut vous emmener à une réunion de son club. Vous ne voulez pas vous opposer directement à elle, mais vous refusez de vous laisser entraîner.
6. Vous êtes invité pour la première fois chez les parents d’un copain. Au cours de la discussion, on vous demande votre opinion sur un sujet épineux. Votre opinion est opposée à celle de la famille, mais vous ne voulez pas vous brouiller avec Marcel. Improvisez la scène.
Retenons
Pour répondre à un interlocuteur sans être impoli(e) et sans le heurter de front, on peut prendre de la distance et marquer qu’on ne veut pas entamer une discussion.
On peut également prendre des précautions, et être prudent dans ses affirmations, pour éviter les erreurs ou prendre de la distance par rapport aux paroles que l’on cite ou que l’on évoque.
Les journalistes utilisent fréquemment ce procédé pour éviter les procès.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 4e, Nathan, 1998.
Fiche 16 : Faire des reproches
OBSERVATION
(Deux personnes dialoguent dans un local de service après-vente.)
— Bonjour, monsieur, qu’est-ce qui se passe ?
— Oui. C’est inadmissible. Ce répondeur téléphonique, qu’on m’a offert pour mon anniversaire, ne fonctionne pas.
— Ah ! c’est assez surprenant. On n’a jamais eu d’ennui avec ce genre d’appareil.
— Regardez-moi cette notice ! On n’y comprend rien ! Impossible d’enregistrer le message d’appel !
— Excusez-moi. Vous avez bien mis l’appareil sous tension ?
— Vous vous moquez de moi ! Comment osez-vous ? Je ne vous permets pas. Vous me prenez pour un imbécile. Ça ne va pas se passer comme ça. Appelez-moi le directeur.
QUESTIONS
1. Dans quelles circonstances ces paroles sont-elles prononcées ?
2. Quel rapport existe entre les interlocuteurs ?
3. Quelles formes grammaticales, quel vocabulaire permettent d’exprimer les reproches ?
POUR FAIRE DES REPROCHES
1. Le vocabulaire à employer
les verbes
courant : reprocher, reprendre, gronder, houspiller, faire la leçon, faire la morale, critiquer, faire honte…
soutenu : blâmer, admonester, sermonner, morigéner, tancer, chapitrer, dire son fait, incriminer…
familier : attraper, disputer, savonner, laver la tête, passer un savon, enguirlander, secouer les puces, river son clou, clouer le bec, rentrer dans le chou, tomber sur le casaquin, (le paletot), voler dans les plumes, mettre dans les gencives…
Les expressions
Je n’admets pas… — Je ne supporte pas… — Je ne vous permets pas de… — Tu m’as menti (désobéi, fais mal…) — Tu as eu tort… — Après tout ce que j’ai fait pour toi !
Tous les défauts : ex : Tu es paresseux, sale, gourmand, vaniteux, égoïste, indiscipliné, faible, lâche, ingrat !…
2. Les formes grammaticales
L’obligation : imparfait/conditionnel
— Il ne fallait pas faire… — Il fallait faire… — Tu aurais dû… — Tu n’aurais pas dû… — Tu devais…
Ne… que :
— Tu ne penses qu’à toi. — Tu ne dis que des bêtises. — Elle ne parle que d’elle-même.
L’intensité :
— Tu parles trop ! — Tu exagères ! — Ça suffit ! — Assez ! — Tu sais que ce n’est pas très gentil de… ; pas beau de… — Tu n’as pas assez travaillé. — Ce que tu as ronflé cette nuit !
Les adverbes : toujours, jamais…
— Tu ne viens jamais me voir. — C’est toujours moi qui écris. — Je vous ai déjà dit… ai dit plusieurs fois… maintes fois…….. — Je ne cesse de vous répéter…
Fausse interrogation (On n’attend pas de réponse) :
— Je me demande comment tu as pu… — Comment as-tu pu oser faire cela ? — Comment oses-tu ? — De quel droit as-tu fait cela ? — C’est bientôt fini ? — T’as vu ta tête, aujourd’hui ?
Certaines expressions familières exclamatives :
— J’en ai marre ! — Ça suffit ! — Ne vous gênez pas ! — Et alors ! — Ah non ! ça alors ! — Non, mais dites donc ! — Pour qui tu te prends ! — Tu ne t’es pas regardé !
La négation :
— Ce n’est pas un travail, ça ! — Ce n’est plus une classe ! — Tu n’es pas un homme !
3. Les figures de style
Certaines comparaisons et métaphores stéréotypées :
— Tu écris comme un chat ! — Tu manges comme un cochon ! — Tu ressembles à ton père ! — On dirait un voyou. — Qu’est ce que c’est que ce cirque ! — Tu es bête à manger du foin ! — Tu mens comme tu respires !
Les proverbes :
Ils permettent d’exprimer des reproches dans des situations très précises :
— Qui vole un œuf vole un bœuf. — Qui se ressemble s’assemble. — Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. — Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute. Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. — L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. — Tel père tel fils ! — Atteler la charrue avant les bœufs. — Les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs.
L’ironie (antiphrase) :
— Faites comme chez vous ! — Vous voulez mon portefeuille (sans doute ? peut-être ? aussi ?) — Allez-y, ne vous gênez pas !
Reproches implicites (déguisés) :
— Ça sent la fumée ici ! — Tiens il n’y a plus de chocolat ! — Plus rien à boire ? à manger ?
EXERCICES
Improvisez les scènes suivantes en utilisant le vocabulaire et les formes grammaticales de la leçon :
1. Un père de famille lit le bulletin trimestriel de son fils. Les résultats sont très mauvais.
2. On vient de prendre la place de parking qu’un automobiliste guettait depuis un quart d’heure.
3. Une mère reproche à son fils d’arriver en retard au repas : — elle est d’abord calme — elle devient ironique — elle s’énerve.
4. Un frère aîné reproche à son jeune frère de lui prendre toujours ses affaires (vêtements, jeux, articles de sport, disques, cassettes).
5. Votre cousine vous téléphone pour vous reprocher de ne pas lui avoir donné de vos nouvelles depuis un mois.
6. Le professeur rend un devoir. Il reproche à ses élèves de n’avoir pas fait les recherches demandées, d’avoir passé trop peu de temps sur le travail…
7. Deux personnes jouent aux cartes : l’un reproche à l’autre de mal jouer, l’autre lui reproche de tricher.
8. Un copain est furieux : on lui a caché son sac juste avant le début des cours. Il ne sait pas qui lui a joué ce tour.
9. Une vieille dame est bousculée en montant dans l’autobus.
10. Les voisins font la fête sans avoir prévenu. Il est quatre heures, vous devez vous lever à six heures…
Retenons
Le reproche s’adresse toujours à une personne présente dans une situation de communication directe. Lorsqu’on parle de quelqu’un d’absent, il s’agit non d’un reproche mais d’une critique.
Faire des reproches c’est s’arroger une forme d’autorité sur quelqu’un.
Le choix des formules dépend du degré d’autorité que l’on s’accorde. L’ironie, les proverbes, les reproches implicites permettent de masquer plus ou moins cette relation d’autorité.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 4e, Nathan, 1998.
Fiche 17 : Répondre à une accusation
Observation
— Monsieur, vous rouliez à 78 km/h en ville. La limite est de 50 km/h.
— Comment ? Mais ce n’est pas possible ! Il doit y avoir une erreur…
— Si, c’est certain. On vous a contrôlé au radar.
— Ce n’est pas ma faute. Il faut que j’aille chercher ma belle-mère à l’hôpital. Je ne vois pas où est le mal.
— Garez-vous là. Vous allez subir un alcootest.
— Entendu. je regrette vraiment. Mais faute avouée est à demi pardonnée…
Questions
1. Quel est le personnage dominant ? le personnage dominé ? Pourquoi ?
2. Quel reproche est formulé ?
3. Quelle excuse l’automobiliste invoque-t-il ?
4. Comment se défend-il ? Quelles formules emploie-t-il ?
Leçon
Pour se défendre contre une accusation, on peut :
— utiliser des excuses ou des arguments :
Ex. J’étais malade, je ne savais pas bien ce que je faisais. On n’a toujours dit que c’était bien de…
— évoquer un sentiment personnel :
Ex. : Je vous comprends : moi-même, je me suis mis en colère quand…
— faire appel à un autre sentiment chez son accusateur :
Ex. : Ayez un peu de compassion pour mon cas…
— faire une supposition tout à fait irréalisable :
Ex. : Et si vous aviez été à ma place, je suis sûr que…
— se présenter soi-même comme une victime :
Ex. : Les apparences sont contre moi. En fait, c’est toi qui…
Il existe de nombreux moyens de répondre à une accusation. Tout dépend de la situation dans laquelle on se trouve, et des interlocuteurs.
On peut cependant retenir quelques moyens, selon que l’on désire :
nier une accusation :
— Ce n’est pas vrai du tout ! C’est (absolument) faux !
— Je nie absolument les faits. Je suis innocent. Je suis hors de cause. Je suis accusé à tort, faussement, injustement.
— Je (te) vous jure que ce n’est pas vrai ! je démens, je conteste, je proteste
— Moi, faire une chose pareille ? Jamais ! Ce n’est pas possible, je vous le jure.
— Non, mais ça va pas ! (fam.)
accepter l’accusation puis l’atténuer à l’aide d’arguments ou en faisant appel à des sentiments :
— D’accord, je l’ai fait mais… Bien sûr, j’ai fait ceci, mais je ne comprends pas ce qui vous choque.
— Je ne vois pas où est le mal.
— Ce n’est pas ma faute, c’est.
— Cela se pratique couramment. De plus… Et puis…
— Si vous saviez comme je l’ai regretté !
— C’est excusable, c’est pardonnable. Il n’y a pas de quoi fouetter un chat. Faute avouée est à demi pardonnée.
retourner l’accusation contre l’interlocuteur :
— Vous le faites bien, vous !
— Mais, vous avez parfois donné l’exemple !
— Commencez donc par balayer devant
votre porte ! (langage familier)
Exercices
1. Un père de famille compréhensif reproche à son fils étudiant de beaucoup sortir, de ne pas préparer assez sérieusement ses examens. Celui-ci répond à son père.
2. Un de vos amis vous reproche de n’être pas venu au rendez-vous qu’il vous avait fixé : vous deviez aller au cinéma ensemble.
3. Votre grand frère vous a surpris en train de fumer. Il vous a sévèrement grondé. Vous répondez.
4. Votre grande sœur vous accuse d’avoir fouillé ses affaires personnelles, d’avoir utilisé son maquillage et lu son journal intime. Répondez-lui.
5. Après une compétition sportive, vos adversaires vous reprochent de vous être dopé. Vous répondez.
6. Vous assistez en tant que délégué au conseil de fin de trimestre. Les professeurs reprochent aux élèves de mal travailler. Vous défendez vos camarades.
7. Vos voisins vous reprochent de travailler votre violon à des heures où ils essaient de se reposer.
Retenons
Pour se défendre contre une accusation, on peut utiliser des excuses ou des arguments ; évoquer un sentiment personnel ; faire appel à un autre sentiment chez son accusateur ; faire une supposition tout à fait irréalisable ; se présenter soi-même comme une victime.
Dans ce cas :
— l’accusation peut être niée ;
— l’accusation peut être acceptée, mais minimisée, atténuée ;
— l’accusation peut être retournée contre l’accusateur.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 4e, Nathan, 1998.
Fiche 18 : Vouloir, pouvoir, devoir
Observation
(Arrivée d’un groupe de jeunes dans un camp de vacances ; une monitrice, des jeunes des deux sexes)
La monitrice. — Tout le monde est là ? Vous pouvez poser vos sacs dans les tentes.
Un jeune. — Où est-ce qu’on peut se laver le matin ?
La monitrice. — Les douches sont à côté des tentes.
Deux gamines. — On voudrait être dans la même tente.
La monitrice. — Oui, c’est d’accord. Vous devez tous vous dépêcher pour être à l’heure au déjeuner.
Un jeune. — Quelle heure il est ?
La monitrice. — Il doit être midi. Dans dix minutes, tous les groupes pourront aller à la cantine.
Questions
1. Dans quelle phrase le verbe pouvoir exprime-t-il la possibilité ? dans quelle(s) phrase(s) exprime-t-il la permission ?
2. Quel verbe exprime une intention, un désir ?
3. Dans quelle phrase le verbe devoir exprime-t-il une obligation ? un fait probable ?
Leçon
1. Le vouloir
(je ne veux pas, je ne veux plus)
je veux bien)
|
• l’intention |
• la décision |
• le renoncement |
|
j’ai l’intention de m’en aller |
j’ai décidé de, j’ai pris la décision de, |
je renonce à m’en aller |
|
• la volonté |
• la tolérance |
• la résignation |
|
j’aurais voulu, je voudrais, je voulais m’en aller |
je veux bien, je tolère, je comprends, j’admets, je supporte, je ne m’oppose pas à, je ne vois pas d’inconvénient à…, |
je ne voulais pas |
2. le pouvoir
|
• La capacité |
• l’incapacité |
• la permission |
|
avoir les moyens de |
ne pas pouvoir, avoir du mal à, ne pas avoir les moyens de, avoir des difficultés à
|
avoir le droit de |
|
• l’éventualité |
• la concession |
|
|
risquer |
même si |
|
3. Le devoir
|
• l’obligation |
• la certitude |
|
il faut… je suis obligé de… tenu de… j’ai à… |
certainement, sûrement, vraiment, réellement, bien sûr, évidemment, manifestement, indiscutablement, incontestablement, |
|
• la probabilité |
• l’intention |
|
sans doute, probablement, je pense que |
en principe, normalement, il va, il veut |
Exercices
1. Claire explique à Élodie comment elle doit s’y prendre pour se faire de nombreux amis.
2. Votre sœur aînée vous donne des conseils pour vous comporter avec un professeur qu’elle a eu l’année précédente et que vous avez cette année.
3. Quentin et Diane, qui ne se sont pas vus depuis dix ans, se rencontrent et s’échangent de leurs nouvelles.
4. Votre grand-frère est très en retard. Vous envisagez de nombreuses possibilités pour rassurer vos parents.
5. L’entraîneur réunit ses joueurs pour les derniers conseils avant le match.
6. Enumérez tout ce que vous pouvez, devez, voulez faire avant de prendre le train.
7. Toute la classe discute pour repeindre et réaménager le foyer des collégiens et le CDI.
Retenons
L’expression du « vouloir » peut se faire avec des verbes comme avoir envie de, désirer, souhaiter, exiger. Ces verbes sont construits avec le subjonctif.
L’expression du « pouvoir », de l’éventualité, peut se faire par de nombreux verbes : avoir la possibilité de, être capable de, être en mesure de…
Le contraire « ne pas pouvoir » peut s’exprimer avec les verbes précédents à la forme négative et : avoir du mal à, avoir des difficultés à, ne pas avoir les moyens de…
L’expression de « devoir » est double : elle peut exprimer une obligation externe, quand des circonstances extérieures obligent à agir (je suis obligé de…), ou une obligation interne (morale personnelle, règles de vie : je m’oblige à…). Elle se fait le plus souvent avec des constructions impersonnelles (il faut que…).
« Devoir » peut aussi exprimer la probabilité.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 4e, Nathan, 1998.
Fiche 19 : Exprimer des souhaits, des regrets
Observation
(Conversation dans la cuisine ou ailleurs…)
— Si seulement je pouvais partir en Italie chez ma correspondante !
— J’espère que tu iras avec ta classe ?
— Malheureusement, je n’ai pas de très bons résultats ce trimestre.
— C’est regrettable. Il est à souhaiter que tu t’améliores ! J’aurais dû aller le prof.
— Hélas, si seulement mon frère m’aidait !
— À mon grand regret, moi, je ne peux rien pour toi.
Questions
1• Qui sont les personnes en présence ? Caractérisez leur âge, leur statut, les rapports qui les unissent.
2• Que devinez-vous de la situation de communication ?
3• Relevez d’une part, les expressions du souhait, d’autre part, celles du regret.
Leçon
Pour exprimer un souhait :
Je souhaite (vivement) que + subjonctif.
Je souhaite + infinitif
Tout ce que je souhaite, c’est que + subjonctif.
Il est à souhaiter que + subjonctif.
J’espère que + indicatif.
Il est à espérer que + indicatif.
On peut + infinitif.
Il faudrait + infinitif./ Il faudrait que + subjonctif.
J’ai bon espoir que + indicatif.
Je garde l’espoir que + indicatif.
Je compte bien que + indicatif. futur/+ infinitif.
Pourvu que + subjonctif.
(Ah !) Si seulement + imparfait de indicatif
Puisse-t-il + infinitif.
Si je pouvais + infinitif.
Si j’étais…
Je voudrais (bien) (tellement)
J’aimerais (tant) (bien)
— Pour exprimer le souhait, il existe des formules toutes faites que l’on emploie dans certaines circonstances :
• Je vous souhaite une bonne année, un bon anniversaire, de bonnes vacances
• Tous mes vœux de bonheur
• Bon anniversaire ! • Amusez-vous bien !
• Bonne fête ! • Bon appétit !• Bon voyage ! • Bonne route !• Bon courage !• Meilleure santé !
Pour exprimer un regret :
Je regrette que + subjonctif.
Je regrette de + infinitif.
Je regrette + nom
À mon grand regret,
Il est regrettable que + subjonctif.
Il est (bien) dommage que +
Quel dommage que + subjonctif.
Dommage !…
Malheureusement…
Hélas !…
Si seulement…
Pourquoi n’est-il pas…
Je m’en veux de + infinitif/que + subjonctif.
Qu’est-ce que c’est bête… J’aurais dû + infinitif.
Si j’avais su… J’aurais pu…
Si j’avais imaginé — que c’était ça — ça Que n’ai-je pas + infinitif.
Exercices :
1. Quels souhaits formulez-vous pour l’an 2020 : • pour votre famille • pour votre meilleur (e) ami • pour vous-même ?
2. En employant des formules variées, vous adressez à quelqu’un des souhaits
— pour sa fête — pour son anniversaire — pour le premier janvier — pour la naissance d’un enfant — à l’occasion d’une hospitalisation.
3. Exprimez le regret :
— vous ne pouvez pas vous rendre à une invitation
— vous ne pouvez pas acheter les mêmes chaussures de sport que votre copain
— vous ne pouvez pas garder le chien de la voisine pendant les vacances.
— vous ne voulez pas prêter le dernier CD de Stomy à votre grand frère.
4. Improvisez à deux une situation au cours de laquelle sera prononcée une des phrases suivantes, au choix :
— Si je pouvais sécher ce cours !
— Pourvu que je ne sois pas interrogée !
— Quand est-ce qu’ils vont enfin partir !
— Pourvu qu’elle ne me voie pas !
— S’ils pouvaient enfin me rembourser !
5. Improvisez une des deux situations suivantes :
• Deux jeunes sur une moto, sans casque, sont arrêtés par un agent. Les casques sont dans le porte-bagages.
• Dans le train, une dame très distraite, accompagnée d’un bébé, d’un chien, et très encombrée de bagages a oublié de composter son billet. Arrive le contrôleur. Dans un second temps, un voyageur s’interpose.
Résumé
Pour exprimer le souhait ou le regret, on dispose d’un certain nombre de formules toutes faites, adaptées à certaines circonstances bien précises.
Quand on exprime le souhait ou le regret avec une subordonnée complétive, le verbe de celle-ci est le plus souvent au subjonctif.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 4e, Nathan, 1998.
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Fiche 20 : INTRODUIRE, ENCHAINER ET CONCLURE
Un expert fait un exposé devant le conseil municipal :
— Nous allons aborder le problème de la circulation alternée en ville.
— Dans un premier temps, il faut étudier les circonstances qui poussent les pouvoirs publics à prendre une telle mesure.
— Ensuite, nous parlerons des difficultés posées aux automobilistes qui se rendre au travail.
— Enfin, nous terminerons par l’examen des autres possibilités de lutte contre la pollution des grandes villes.
— Cette étude nous permettra de montrer combien il est difficile de résoudre rapidement le problème.
Question
1. Quel est le problème abordé ?
2. Quels points de l’exposé sont annoncés ?
3. Quels moyens permettent d’introduire, d’enchaîner et de conclure ?
Leçon
Pour marquer le début d’un développement
Nous aborderons…, nous parlerons de…, nous verrons…
J’aborderai… Je considérerai… Je parlerai de, je présenterai…
Nous allons aborder… Je vais considérer… parler de…
Je commencerai par aborder (+ nom). Nous verrons que… On peut avancer que… La première remarque que l’on puisse faire est que… Parlons d’abord de… Partons de l’observation… Le premier problème à traiter, c’est… aborder,
Tout d’abord,…. En premier lieu… Dans un premier temps,….
Pour enchaîner
Venons-en maintenant à…, passons au point suivant, Venons à l’aspect suivant, Passons à présent à…
Premièrement, Deuxièmement
Premier point, Deuxième point
En premier lieu, En second lieu
Ensuite, Puis, En outre, De plus, Par ailleurs
Quant à, Pour ce qui est de, Reste à parler de
Le dernier point
Je terminerai, Nous terminerons
Enfin,
Insister sur un point :
J’étudierai davantage, je développerai, je vais un peu m’étendre sur
Passer rapidement sur un point :
Je ne développerai pas, je ne m’étendrai pas sur, je m’en tiendrai à, je passerai rapidement sur
Donner un exemple, illustrer :
Prenons un exemple, par exemple, ainsi…
J’illustrerai ce point par une anecdote
Entre parenthèses, cela me fait penser à, cela rappelle
Résumer :
En somme, en gros, pour tout dire
Ce qu’il faut retenir, l’essentiel c’est
Pour me résumer, en résumé
Pour conclure :
En conclusion…, pour finir, Pour conclure…
Je conclus…, On peut donc conclure que…
Cela nous permet de dire pour terminer…, de conclure que…
Au bout du compte…
La conclusion (de tout cela), c’est que…
Cela montre que…
Donc…
Ainsi…
Finalement…
En conséquence…
En résumé…
Par conséquent…
Exercices
Voici quelques sujets d’exposés, dans les différentes matières du programme de la Quatrième. Exercez-vous en élaborant un plan pour traiter le sujet :
1. Les langues en Europe.
2. La Prise de la Bastille.
3. Louis Pasteur et ses découvertes.
4. La presse quotidienne régionale dans votre département.
5. Le SIDA et les MST.
6. La santé et la sécurité.
7. La contraception.
8. Les atteintes à l’environnement
9. Les volcans.
10. La conservation du patrimoine.
Retenons
Écouter un exposé ou un cours réclame un effort d’attention important. Il est donc indispensable, quand on fait un exposé, de maintenir le contact avec l’auditoire.
Un des moyens de le faire est de disposer des repères destinés à signaler les parties importantes, les épates de l’exposé, les exemples.
Remarque : Ces formules sont les mêmes à l’oral et l’écrit.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 4e, Nathan, 1998.
Fiche 21 : Poser des questions persuasives
Objectif : persuader ou mettre en difficulté un interlocuteur en le questionnant.
Leçon
Les questions persuasives étant souvent de nature à mettre en difficulté celui à qui vous les adressez, il convient de bien tenir compte du rang ou de la situation de votre interlocuteur afin de ne pas prendre le risque de l’humilier ou de l’indisposer s’il a un quelconque pouvoir sur vous : on imagine mal par exemple un candidat à un examen posant une question piège aux membres du jury…
Il existe quatre types de questions persuasives :
1. Les questions orientées
|
Amener l’interlocuteur à découvrir |
en employant une |
Ne serait-ce pas toi par hasard qui… ? |
ou à reconnaître |
en employant un |
À quel meilleur conseiller qu’un |
La question orientée est toujours fermée et attend une réponse de type oui/non, quelqu’un/personne, mais l’interlocuteur n’a pas le choix parce que sa réponse est induite par la question.
2. Les questions pièges
|
Mettre un |
en lui faisant indirectement avouer ou |
Avec qui as-tu dansé à la discothèque ? |
en difficulé |
en posant une question très |
Vous qui êtes si fort en géographie, |
3. La question de controverse
|
Faire réagir |
en le déstabilisant |
Vous parlez des jeunes, mais sommes-nous du même monde ? |
4. Les contre-questions
|
Reprendre l’initiative du débat |
en posant, en guise de réponse, une question de contre-attaque |
— Que pensez-vous de votre absence sur la feuille de match ? |
|
Exercices
1. À quel type de question persuasive avez-vous affaire ?
1. Qui avez-vous rencontré mardi dernier à la gare ?
2. Êtes-vous totalement satisfait de votre dernier disque ?
3. Depuis que vous êtes entraîneur de cette équipe, vous perdez match sur match. Allez-vous démissionner ?
4. Monsieur le Ministre des Finances, pourriez-vous me donner le prix du ticket de métro actuellement ?
5. Est-ce que je vous demande, moi, chez qui vous achetez vos chaussures et quel prix vous les payez ?
2. Avec des camarades, improvisez les scènes suivantes.
— Vous voulez vous débarrasser d’un vieux VTT et vous vantez ses qualités auprès d’éventuels acheteurs. Pour vous, il n’y a pas meilleur VTT…
— Vous êtes complètement « fan » d’un chanteur ou d’une chanteuse et vous voudriez que vos amis partagent votre passion. Vous leur faites découvrir qu’eux aussi adorent cette star.
3. À partir de la situation suivante, improvisez une scène dans laquelle vous justifiez votre choix.
— Vous allez à la pêche avec un voisin beaucoup plus jeune que vous. Surpris par un violent orage, vous rentrez précipitamment abandonnant provisions et matériel de pêche au bord de la rivière. De retour à la maison, vous expliquez à vos parents que vous avez pris la meilleure décision.
— Vous participez à une finale départementale de football avec votre association sportive. Afin d’éviter un but éliminatoire, vous commettez une faute que l’arbitre sanctionne par une expulsion. Après la rencontre, vous expliquez dans les vestiaires à vos coéquipiers déçus que vous n’aviez pas le choix.
4. Avec des camarades mettez en scène les interviews suivantes.
— Un journaliste essaie de faire reconnaître à un coureur cycliste qu’il s’est dopé. Le journaliste utilise toutes les questions persuasives, le coureur, gêné, se défend avec des questions de contre-attaque et avec des questions orientées.
— Un journaliste interroge le leader d’un groupe célèbre. Il veut absolument faire reconnaître au chanteur qu’il y a une mésentente entre les musiciens et que le groupe va bientôt se séparer.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 3e, Nathan, 1999.
Fiche 22 : Réfuter pour argumenter
Objectif : maîtriser une stratégie pour refuser sans blesser son interlocuteur
Leçon
Quand on n’approuve pas quelqu’un on a parfois intérêt, si on veut le faire changer d‘avis ou si les circonstances ne le permettent pas, à éviter un affrontement direct qui risque de le vexer, mieux vaut alors…
ne pas prendre parti :
Sans doute, mais il y a peut-être une autre manière de voir les choses…
Ce n’est pas aussi simple que ça…
Vous pensez vraiment cela ?
N’exagérons rien.
présenter des regrets ou des excuses avant d’argumenter :
Désolé, mais…
Je regrette mais il faut que je…
C’est dommage, mais…
ne pas blesser tout en gagnant du temps :
Je vais voir.
Je vais réfléchir.
Je vais y penser.
Je ne peux pas vous répondre maintenant.
(Je ne dis pas non, mais) laissez-moi le temps de réfléchir.
Excusez-moi, mais il faut que j’en parle à…
Il est encore trop tôt pour…
manifester un accord partiel pour mieux réfuter :
Ce que vous dites est vrai… mais…
Je suis entièrement d’accord… cependant…
C’est évident… pourtant…
Je partage cet avis… mais peut-être que…
Exercices
1. Retrouvez les répliques qui ont suscité les réflexions suivantes.
— J’aimerais bien, mais j’ai promis d’emmener ma sœur au cinéma ce soir.
— Je n’y vois pas d’inconvénient, mais il faut que j’en parle à mes musiciens.
— Vous me l’auriez dit plus tôt, je pouvais faire quelque chose pour vous.
— Je n’en ai plus dans cette taille, mais je peux vous en commander pour la semaine prochaine.
2. Mettez en scène les situations suivantes :
— Votre père est policier. Vous êtes invité chez une amie dont les parents à table critiquent sévèrement les policiers, mais par égard pour votre amie, vous ne voulez pas vous opposer ouvertement à eux.
— Votre coiffeuse s’en prend aux jeunes de la cité voisine qu’elle considère comme délinquants. Selon elle, il faudrait tous les arrêter : à travers quelques questions orientées, elle voudrait que vous vous rangiez à son avis.
3. Répondez aux arguments suivants sans vexer votre interlocuteur.
— On devrait interdire la mendicité au centre-ville.
— Si les routes étaient mieux entretenues par les pouvoirs publics, il y aurait moins d’accidents.
4. Complétez le dialogue suivant avec des arguments que vous inventerez et jouez ensuite la scène avec un camarade.
Un jeune homme cherche du travail auprès d’un artisan…
L’artisan : — De toute façon, les jeunes aujourd’hui ne veulent rien faire.
Le jeune (timidement) : — Ce n’est peut-être pas aussi simple que ça.
L’artisan : — La France est un pays d’assistés, jeune homme ! Moi, de mon temps, il n’y avait ni bourses ni RMI…
Le jeune : — N’exagérons rien, on ne peut pas généraliser comme ça.
L’artisan : — Tenez, vous, je vous engage comme apprenti. Nous ouvrons à sept heures et fermons à dix-huit heures. Pour le salaire, nous verrons plus tard.
Le jeune : — Je ne dis pas non, mais laissez-moi le temps de réfléchir.
L’artisan : — C’est bien ce que je disais, vous êtes comme les autres.
Le jeune : — Je regrette mais il faut que j’en parle d’abord à mes parents.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 3e, Nathan, 1999.
Fiche 23 : Condamner un argument
Objectif : maîtriser une stratégie de la réfutation
LEÇON
Pour condamner une explication ou un argument on peut :
1. Faire barrage à une proposition, à une demande ou à une affirmation…
2. S’en prendre
a. à son interlocuteur
b. à ses propos
EXERCICES
1. Mettez en scène avec un(e) camarade les situations suivantes.
a. Vous entrez dans un magasin et vous demandez à une charmante vendeuse le tee-shirt bleu de taille trente-huit que vous avez vu en vitrine. Elle vous quitte un instant et revient en vous disant qu’elle n’a plus ce modèle mais que ce n’est pas grave puisqu’elle vous en recommande un jaune, de taille quarante qui selon elle vous ira comme un gant. Vous refusez avec tact et courtoisie.
b. Un(e) ami(e) vous demande de lui prêter cent euros alors qu’il (elle) ne vous a toujours pas rendu les deux cents euros que vous lui aviez avancés pour le (la) dépanner. Vous refusez fermement tout en veillant à préserver une amitié à laquelle vous tenez beaucoup.
2. Mettez en scène avec plusieurs camarades les situations suivantes.
a. Vous passez quelques jours aux sports d’hiver. Un après-midi, plusieurs camarades tentent tour à tour de vous convaincre de les accompagner dans une sortie hors piste. Vous résistez à chacun en utilisant plusieurs types d’arguments évoqués dans la leçon.
b. Vous passez un samedi soir chez des parents proches. La maîtresse de maison, soutenue par ses enfants qui sont fiers d’elle, tient absolument à vous faire goûter plusieurs gâteaux qu’elle a préparés. Soucieux (-euse) de votre ligne, vous refusez d’abord poliment, puis excédé(e) par l’insistance de vos hôtes, vous devenez plus catégorique.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 3e, Nathan, 1999.
Fiche 24 : Présenter des objections
Objectif : maîtriser une stratégie de réfutation partielle.
LEÇON
On prendra toujours soin de rassurer d’abord son interlocuteur en rappelant les points sur lesquels on est d’accord avec lui avant d’en venir aux objections ; cette précaution permet de le rendre plus disposé à écouter ce qui n’est pas forcément agréable pour lui.
Les objections sont des arguments que l’on oppose à une affirmation, à une demande ou à une opinion pour la réfuter : sans être en total désaccord avec son interlocuteur, on a cependant parfois besoin de souligner quelques points de divergence avec lui pour le faire évoluer vers un compromis acceptable. On peut alors…
EXERCICES
1. Soulignez les attitudes pragmatiques et encadrez les positions de principe.
1. Une salle de spectacle doit avoir deux issues de secours. — La fenêtre servira d’issue de secours. 2. Monsieur, passez le premier puisque vous êtes blessé.- Les femmes et les enfants d’abord.
2. Mettez en scène les situations suivantes avec plusieurs camarades.
— Deux adolescents demandent à leurs parents réticents l’autorisation de partir seuls en vacances.
— Des grévistes réclament à leur patron une augmentation de salaire.
Fiche publiée dans Grammaire et activités 3e, Nathan, 1999.
Fiche 25 : Les progressions thématiques
Observation
Texte 1
Colin regardait Alise. Elle portait, par un hasard étrange, un sweat-shirt blanc et une jupe jaune. Elle avait des souliers blanc et jaune et des patins de hockey. Elle avait des bas de soie fumée et des socquettes blanches repliées sur le haut des chaussures à peine montantes et lacées de coton blanc, faisant trois fois le tour de la cheville. Elle comportait en outre un foulard de soie vert vif et des cheveux blonds extraordinairement touffus, encadrant son visage d’une masse frisée serré. Elle regardait au moyen d’yeux bleus ouverts et son volume était limité par une peau fraîche et dorée. Elle possédait des bras et des mollets ronds, une taille fine et un buste si bien dessiné que l’on eût dit une photographie.
Boris Vian, L’Écume des jours
Texte 2
Il entra, gratta ses pieds sur une grille luisante aux lames acérées et suivit un couloir bas bordé par des lampes à lumière pulsée. Tout au bout du couloir, il y avait une porte. Elle portait le numéro indiqué dans le journal et il entra sans frapper comme le recommandait l’annonce.
Boris Vian, L’Écume des jours
Texte 3
De forme sensiblement carrée, assez élevée de plafond, la chambre de Colin prenait jour sur le dehors par une baie de cinquante centimètres de haut qui courait sur toute la longueur du mur à un mètre vingt du sol environ. Le plancher était recouvert d’un épais tapis orange clair et les murs tendus de cuir naturel. Le lit ne reposait pas sur le tapis mais sur une plate-forme à mi-hauteur du mur. On y accédait par une petite échelle de chêne syracusé garnie de cuivre rouge blanc. La niche formée par la plate-forme, sous le lit, servait de boudoir. Il s’y trouvait des livres et des fauteuils confortables, et la photographie du Dalaï-Lama.
Boris Vian, L’Écume des jours
Questions
1. Dans chacun des textes, repérez le thème des phrases, c’est-à-dire les groupes de mots qui servent de point de départ à chacune d’entre elles.
2. Comment les thèmes s’enchaînent-ils d’une phrase à l’autre, dans chacun des textes ?
Leçon
Du point de vue de l’information, un texte est constitué à la fois de la reprise d’éléments déjà présentés antérieurement (thèmes) et de l’apport d’informations nouvelles (propos).
Quand on étudie la progression du texte on peut distinguer deux cas :
— le thème est en rapport avec un élément de la phrase précédente : on dit qu’il y a continuité ;
— le thème est nouveau par rapport aux éléments de la phrase précédente : on considère qu’il y a renouvellement dans les thèmes.
1. Les progressions thématiques types
A. la progression à thème constant
Certains passages présentent une suite de phrases dont les thèmes sont la reprise de celui de la phrase précédente, soit sous forme de pronom, soit sous la forme d’une reprise nominale (voir p. 00)
Le thème constant est associé, d’une phrase à l’autre, à différents propos.
C’est le cas de l’extrait 1 de L’Écume des jours.
B. la progression linéaire ou en escalier
Certains passages présentent une suite de phrases dont l’enchaînement se fait de proche en proche : le propos d’une phrase (ou une partie de celui-ci) devient le thème de la phrase suivante. Dans ce cas, le thème est nouveau par rapport au précédent, mais la continuité du texte est assurée.
C’est le cas de l’extrait 2 de l’Écume des jours.
C. la progression à thèmes dérivés ou en éventail
Le thème de chaque phrase du passage est identifié par association avec le titre du texte, ou le thème de la première phrase s’il indique le thème général du texte.
Ex. : la chambre de Colin > • le plancher • le lit • la plate-forme • la niche (thèmes dérivés)
2. Progressions thématiques et types de textes
Les progressions thématiques types se retrouvent rarement à l’état pur au-delà de quelques phrases. Elles se combinent au sein de chaque type de texte : narratif, descriptif, informatif, injonctif, argumentatif.
Cependant, on peut constater certaines affinités particulières
A. les séquences narratives
Elles suivent souvent une progression à thème constant. Ce thème constitue le point d’ancrage du passage, indique le déroulement d’une action et offre une unité de point de vue. Il permet de suivre constamment le personnage :
Ex. : Colin reposa le peigne et, s’armant du coupe-ongles, tailla en biseau les coins de ses paupières mates, pour donner du mystère à son regard. Il devait recommencer souvent, car elles repoussaient vite. Il alluma la petite lampe du miroir grossissant et s’en approcha pour vérifier l’état de son épiderme.
Boris Vian, L’Écume des jours
B. les séquences descriptives
•• Elles s’organisent le plus souvent selon une progression à thèmes dérivés : les différents éléments de la description d’un objet, d’un lieu, d’un personnage sont dérivés d’un thème général présent dans la première phrase du passage :
Ex. : La pièce, de quatre mètres sur cinq environ, prenait jour sur l’avenue Louis-Armstrong par deux baies allongées. Des glaces sans tain coulissaient sur le côté et permettaient d’introduire les odeurs du printemps lorsqu’il s’en rencontrait à l’extérieur. Du côté opposé, une table de chêne souple occupait l’un des coins de la pièce. Deux banquettes à angle droit correspondaient à deux des côtés de la table et des chaises assorties, à coussins de maroquin bleu, garnissaient les deux côtés libres.
Boris Vian, L’Écume des jours
•• Quand la description est faite du point de vue d’un personnage et intégrée dans le récit, elle suit une progression à thème constant :
Ex. : Colin choisit une nappe bleu clair assortie au tapis. Il disposa, au centre de la table, un surtout formé d’un bocal de formol à l’intérieur duquel deux embryons de poulet semblaient mimer le Spectre de la Rose, dans la chorégraphie de Nijinsky. [Alentour, quelques branches de mimosa en lanières : un jardinier de ses amis l’obtenait par croisement du mimosa ordinaire, en boules, avec le ruban de réglisse noir que l’on trouve chez les merciers en sortant de classe.] Puis il prit, pour chacun, deux assiettes de porcelaine croisillonnée d’or transparent, un couvert d’acier inoxydable aux manches ajourés, dans chacun desquels une coccinelle empaillée, isolée entre deux plaquettes de plexiglas, portait bonheur.
Boris Vian, L’Écume des jours
•• La progression linéaire est également possible pour une description : elle crée un effet de réel en mettant les détails en relief.
Ex. : Un guéridon, un vase contenant des fleurs en papier, puis les rideaux de l’alcôve, le lit, une armoire ; près de l’armoire, une petite porte recouverte de tapisserie. Près de la porte, une chaise ; sur la chaise, des linges, pantalons et jupes brodés.
Jean Giono, Le Hussard sur le toit, © Gallimard.
C. les séquences explicatives
Elles présentent des exemples de toutes les progressions.
•• thème constant :
Ex. : Mercator (1512-1594) fut le plus original et le plus important des géographes. Il avait reçu une excellente instruction. Né en Flandres, il étudie la philosophie et la théologie à l’université de Louvain. Il se tourne ensuite vers les mathématiques et l’astronomie. Sapremière œuvre, en 1537, est une petite carte de Palestine. (D’après D. Boorstin, Les découvreurs, © Laffont, coll. Bouquins.)
•• thèmes dérivés :
Ex. : Nanga Parbat. — Son exploration débute dès 1856. En 1895, Mummery y atteint l’altitude de 6000 mètres, mais il disparaît dans une crevasse avec deux porteurs. En 1953, Hermann Bülh, empruntant le versant NE, atteint le sommet, seul. En 1962, Kinshofer, Löw et Mannhart réussissent le première du versant NO ; en 1970, Günther et les deux frères Messner celle de l’arête Sud.
(D’après Pierre Mazeaud, Les Carnets de l’Aventure)
•• progression linéaire :
ex. : Washington, 1843. — Le Congrès et le Sénat des États-Unis viennent d’accorder enfin 30 000 § à l’inventeur Morse. Grâce àcette somme il pourra améliorer et mettre en œuvre son invention : le « télégraphe magnétique ». Cet instrument qui permet de transmettre des messages à l’aide du courant électrique fonctionne au moyen d’un code dont Morse est l’inventeur.Ce procédé de transmission est une combinaison de points et de traits figurant toutes les lettres de l’alphabet.
D’après le Journal du Monde, © Denoël.
D. les séquences argumentatives
•• Elles se présentent sous forme de thème constant lorsqu’on se contente de juxtaposer, d’additionner des arguments :
Ex. : La culture scientifique des Français est trop peu développée. Elle souffre d’un enseignement scientifique insuffisant dès l’école primaire. Elle devrait être assez développée pour lutter contre le charlatanisme, les superstitions, l’astrologie, les sciences occultes.Elle devrait être plus largement relayée par les médias.
•• Elles se présentent sous la forme de progression à thèmes dérivés qui permettent de développer les différents points d’un raisonnement.
Mais, pour ce type de texte, ce sont surtout les paragraphes qui s’enchaînent de cette manière plutôt que les phrases elles-mêmes. La présence de reprises en début de paragraphe permet de repérer la progression du texte.
Ex. : les paragraphes d’un texte : Le stress du quotidien
1e § « Bien des gens croient que le bonheur dépend de leurs biens matériels… » (suite : stress et bonheur)
2e § « On doit distinguer deux formes de stress… » (suite : stress négatif et stress positif)
3e § « Donc on peut considérer que le stress… » (suite : stress et conception de la vie)
4e § « Pour lutter contre le stress destructeur… » (suite : attitude idéale)
Pour l’expression écrite :
Le choix de telle ou telle progression ne dépend pas particulièrement du type de texte, mais plutôt de l’intention de l’émetteur.
Si l’émetteur veut attirer l’attention sur un objet, il utilisera une progression linéaire qui conduit le regard du lecteur, par un effet de « travelling », vers un détail significatif ou symbolique.
Si l’émetteur veut insister sur un personnage ou une idée, il utilisera plutôt la progression à thème constant.
Si l’émetteur veut ordonner une argumentation complexe, structurer fortement un récit, disposer une description dans l’espace, il utilisera une progression à thèmes dérivés, soulignée par des organisateurs logiques (d’abord, ensuite, enfin), des organisateurs chronologiques (Le matin, en début d’après-midi, le soir), ou spatiaux (à gauche, à droite, au fond…)
3. Les ruptures thématiques
Il y a rupture chaque fois que la progression thématique choisie s’interrompt, et se trouve remplacée par une autre.
A. Dans le récit :
Dans le domaine narratif, les ruptures ou glissements thématiques matérialisent certaines intentions de l’auteur :
• changement de personnage
Exemple : Le jeune homme se reprocha vivement ce qu’il appelait sa balourdise, sa grossièreté, sa sottise. Il errait au hasard, persuadé qu’il ne reverrait plus cette gracieuse créature, lorsqu’il l’aperçut soudain venant à sa rencontre et forcée de passer près de lui dans l’étroit sentier. Elle écartait de ses deux mains nues les plis de son grand manteau. Elle avait des souliers noirs très découverts. Seschevilles étaient si fines qu’elles pliaient par instants et qu’on craignait de les voir se briser.
Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, © Émile-Paul.
• passage du premier plan à l’arrière-plan du récit
Ce procédé se combine avec l’opposition passé simple/imparfait.
Exemple : D’abord elle ne vit rien, aveuglée par cette flamme minuscule comme par un météore, et brusquement elle fut debout sans savoir ce qu’elle faisait. Étendu en travers su grand fauteuil de velours cerise aux reflets de braise, un garçon d’environ dix-sept ans dormait dans une de ces attitudes à la fois tragiques et nonchalantes par lesquelles le sommeil s’apparente à la mort.
Julien Green, Minuit, © Seuil, 1936.
• insertion d’une description et d’un commentaire
Exemple : Elle se tut, et personne n’osa rompre le silence. La pelouse était couverte de faibles vapeurs condensées, qui déroulaient leurs blancs flocons sur les pointes des herbes. Nous pensions être en paradis. Je me levai enfin, courant au parterre du château, où se trouvaient des lauriers plantés dans de grands vases de faïence peints en camaïeu. Je rapportai deux branches qui furent tressées en couronne et nouées d’un ruban. Je posai sur la tête d’Adrienne cet ornement […]
Gérard de Nerval, Sylvie.
B. Dans le raisonnement et l’argumentation
Différents cas peuvent se présenter.
• Introduire une opposition :
Ex. : Isis, en dix-huit ans d’âge, était parvenue à se munir de cheveux châtains, d’un sweat-shirt blanc et d’une jupe jaune avec un foulard vert acide, de chaussures blanches et jaunes et de lunettes de soleil. Elle était jolie. Mais Colin connaissait très bien ses parents.
Boris Vian, L’Écume des jours
• Introduire la cause d’un fait :
Ex. : Une discordance dans le vacarme lui fit soudain lever les yeux. Il chercha d’où provenait le bruit suspect. Un des jets de purification venait de s’arrêter au milieu de la salle et restait en l’air comme tranché en deux. Les quatre machines qu’il avait cessé de desservir trépidaient, on les voyait remuer à distance et devant chacune d’elles, une forme s’affaissa peu à peu. Chick posa son livre et se rua au dehors.
Boris Vian, L’Écume des jours
• Introduire la conséquence :
Ex. : Elle s’en alla par un mouvement de reine. Je sentis alors le ridicule de ma position ; alors seulement je compris que j’étais fagoté comme le singe d’un Savoyard. J’eus honte de moi.
H. de Balzac, Le Lys dans la vallée, 1835.
• généraliser :
C’est passer du concret à l’abstrait.
Ex. : J’aimais à le voir, sans me douter du plaisir que j’y trouvais ; j’étais coquette pour les autres, et je ne l’étais pas pour lui ; j’oubliais à lui plaire, et ne songeais qu’à le regarder. Apparemment que l’amour, la première fois qu’on en prend, commence avec cette bonne foi-là, et peut-être que la douceur d’aimer interrompt le soin d’être aimable.
Marivaux, La Vie de Marianne, 1731-1741.
• particulariser :
C’est, le plus souvent, passer de l’abstrait à l’exemple concret.
Ex. : Gabriel Lecouvreur n’aime pas les églises, il y voit toujours défiler les siècles et les bûchers, il y entend la voix éraillée de Torquemada et les hurlements d’horreur de la Saint Barthélemy. Il s’y sent mal, dans ces sinistres nefs de pierre. Et, ce matin, celle qu’il traverse, en silence est comme les autres, sombre, déserte, à peine illuminée par les petits cierges brûlant devant les chapelles.
Nicloux, Pouy, Raynal, Le Poulpe, le film © Baleine, 1998.
Résumé
Dans un texte, les différentes successions des thèmes (éléments déjà présentés antérieurement) et des propos (informations nouvelles) s’établissent selon des progressions types :
— la progression à thème constant présente une suite de phrases dont les thèmes reprennent celui de la phrase précédente ;
— la progression linéaire présente une suite de phrases dont l’enchaînement se fait de proche en proche : le propos d’une phrase (ou une partie de celui-ci) devient le thème de la phrase suivante ;
— la progression à thèmes dérivés présente une suite de phrases ainsi enchaînées : le thème de chaque phrase du passage est identifié par association avec un thème général, indiqué par le titre du texte, ou le thème de la première phrase.
Dans un récit, les ruptures de progression permettent un changement de personnage, le passage d’un plan à un autre, l’insertion d’une description ou d’un commentaire.
Dans un raisonnement, les ruptures thématiques permettent d’introduire une opposition, une cause, une conséquence, de particulariser, de généraliser…
Leçon publiée dans Grammaire et expression 3e Nathan
Fiche 27 : La modalisation
Observation
Les coffres-forts n’ont pas de conscience
Les banquiers suisses sont muets comme des tombes. Une qualité ou un défaut ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les sbires d’Adolf Hitler ont constitué un énorme trésor de guerre : de l’or par tonnes dérobé dans les banques nationales des pays envahis, volé aux familles juives ou arraché dans la bouche même des victimes des camps de la mort. Et ils ont déposé une partie du magot dans les coffres-forts helvètes d’une discrétion à toute épreuve : en Suisse, le secret bancaire — créé dans les années 30 pour protéger les avoirs des juifs allemands persécutés par le régime nazi ! — est sacro-saint. À la fin du conflit, les Alliés tirèrent l’oreille de Genève. Sans trop se faire prier, la Suisse restitua, en 1946, 336 tonnes de lingots que les vainqueurs empochèrent… sans trop se poser de questions.
Quelques années plus tard, sous la pression des organisations juives internationales et des Etats-Unis, la Confédération consentit à lâcher quelques millions de francs suisses pour dédommager la communauté israélite. Mais on sait aujourd’hui, grâce à l’ouverture récente des archives des services secrets américains et britanniques, que les banques helvètes n’ont rendu que 10 % du pécule nazi. Sans compter l’argent déposé par les victimes du génocide que leurs héritiers n’ont souvent pas pu récupérer : des dizaines de millions de dollars, selon le Congrès juif mondial. Profil bas en Suisse : le gouvernement a accepté de lever le secret bancaire pour que toute la lumière soit faite. L’enquête devrait durer de trois à cinq ans.
Science et Vie Junior N° 86, novembre 1996.
Questions
1. Quelle est la visée du texte : raconter, décrire, informer, convaincre ?
2. L’auteur de ‘article est-il grammaticalement présent dans le texte ?
3. À partir du titre de l’article, quelle hypothèse faites vous sur la position du journaliste ?
4. Relevez, dans l’ensemble du texte des signes de ponctuation qui traduisent un sentiment ? Quel peut être ce sentiment ?
5. Relevez des mots (noms, verbes, adjectifs) qui communiquent le jugement du journaliste sur les faits qu’il rapporte.
6. Quelles expressions vous paraissent ironiques ? Pourquoi ?
7. Quelle source extérieure d’information est citée par le journaliste ? Pourquoi la cite-t-il, à votre avis ?
8. Que marque le temps verbal du verbe de la dernière phrase ?
Leçon
1. Définition
La plupart des énoncés portent la marque de l’émetteur qui les produit.
L’émetteur peut ainsi communiquer ses goûts, ses sensations, ses sentiments, ses émotions, ses opinions.
La subjectivité de l’émetteur se manifeste dans tous les types de textes : narratif, descriptif, explicatif, argumentatif, autant dans les textes sociaux que dans les textes de fiction.
De nombreux indices signalent la présence de l’émetteur dans son énoncé.
On appelle modalisation l’ensemble des éléments qui précisent la position de l’émetteur à l’intérieur de son énoncé.
L’émetteur peut, par exemple :
— marquer les relations entre les interlocuteurs ;
— donner l’information comme sûre ;
— indiquer que l’information qu’il donne n’est que probable.
2. Les différentes modalités
A. la pragmatique :
Certaines modalités rendent compte des relations entre les interlocuteurs, par exemple l’obligation, la permission, le conseil, la promesse, la requête :
Ex. : Vous êtes invité à lire ce roman.
Il vaut mieux ne pas aborder ce sujet avec Pauline.
On n’oubliera pas d’éteindre en sortant des salles.
B. la probabilité :
L’émetteur peut signaler que l’information qu’il donne n’est pas certaine, mais qu’il s’agit plutôt d’une probabilité. Les marques de probabilité sont des auxiliaires de modalité (devoir, pouvoir), les verbes sembler, paraître, le futur antérieur à valeur modale :
Ex. : Pierre doit arriver pour le dessert. Pierre peut avoir oublié l’heure de la réunion. Pierre aura pris froid. Cette chance paraîtinespérée.
C. l’évaluation :
L’émetteur peut exprimer son jugement, positif ou négatif, sur l’information qu’il donne. Cette modalisation s’exprime par le vocabulaire employé, par certains adverbes ou groupes nominaux dont la place est libre dans la phrase, mais qui se place généralement en tête :
Ex. : Heureusement, par bonheur, hélas, à ma grande surprise, il neige à mille mètres d’altitude.
3. Les procédés de modalisation
A. L’intonation (à l’oral), la typographie (mots en gras, en italiques, en capitales), la ponctuation (à l’écrit) peuvent souligner l’affectivité de l’émetteur.
Ex. : Quoi ! tu me soupçonnes…
B. Le vocabulaire
Il peut être mélioratif ou péjoratif :
Ex. : les sbires d’Adolf Hitler ; c’est odieux ; ce garçon est un imbécile./ ce film est mortel, la musique est démente…
C. Certains types de phrases, en particulier les phrases exclamatives et la phrase interrogative quand elle pose de fausses questions. La place de certains groupes dans la phrase peut également renforcer la modalisation
Ex. : Qu’est-ce qu’il mange, ton copain !
Tu me prends pour un imbécile ?
D. les verbes qui expriment une opinion, un jugement, une certitude, une probabilité : devoir, pouvoir, croire, imaginer, prétendre, insinuer, souligner, soutenir, jurer, certifier ;
croire, devoir et pouvoir sont des auxiliaires de modalité : ils servent souvent à poser une modalité sur certaines actions.
Ex. : Arnaud prétend qu’il m’a rendu son devoir la semaine dernière.
Je crois savoir qu’il a déjà invoqué une fois ce prétexte.
Vous devriez relire vos devoirs.
E. les adverbes : peut-être, sans doute, probablement…
Selon la place de l’adverbe dans la phrase, la modalisation n’est pas la même :
Ex. : Sans doute qu’il a mangé des champignons vénéneux.
Il a mangé des champignons sans doute vénéneux.
F. certaines figures de style, en particulier celles de l’ironie : l’antiphrase, la litote, la périphrase connotée.
Ex. : C’est du propre !/Il est si bête que même ses collègues s’en sont aperçus./Le locataire de la mairie de Paris.
4. Modalisation et mise à distance
Dans certains énoncés, l’émetteur peut signaler qu’il ne prend pas la responsabilité de l’affirmation. Il signale que le contenu de celle-ci est, au contraire, à mettre au compte d’une tierce personne.
Ex. : D’après les derniers sondages, la cote de popularité de M. X dépasse celle de M. Y.
Selon un communiqué du palais princier, le mariage de la princesse aura lieu demain après-midi.
En plus de l’information qu’il donne, l’énoncé est marqué par une intervention de l’émetteur qui marque la distance qu’il prend vis-à-vis de l’information :
Ex. : aux dires de l’auteur… d’après X…, à son avis, si l’on en croit…, à l’en croire… selon l’agence Reuter, à l’entendre… si je crois ce qu’on raconte… comme le disait ma grand-mère…
La modalisation peut être marquée par le conditionnel. Dans de nombreux textes scientifiques, le conditionnel marque que l’auteur fait état d’hypothèses non vérifiées, ou de théories qu’il cite ou non, et vis-à-vis desquelles il dégage sa responsabilité.
Ex. : La destitution du président aurait lieu lors de prochain congrès.
Pour l’expression écrite
L’émetteur peut prendre des distances diverses par rapport à l’information qu’il donne : il peut rapporter le discours de quelqu’un, faire une citation, parodier, imiter.
Ex. : Dernier Woody : mauvais Allen (titre de Libération)
Dans les textes narratifs, il est important d’attribuer clairement les paroles, les pensées et les opinions respectives des personnages.
Ex. : Comme le dit ma voisine : « Je ne suis pas raciste, j’ai un chat siamois ».
Dans les textes d’information courante ou scientifique, dans les textes argumentatifs, il est utile de signaler clairement la thèse que l’on défend, et celle (s) que l’on réfute :
Ex. : D’après le Comité d’Ethique, le clonage des êtres humains serait une catastrophe pour l’humanité.
Résumé
L’énoncé porte souvent des marques de l’émetteur, qui communique ses sentiments et ses opinions.
L’émetteur peut également marquer la prise de position sur l’information qu’il rapporte : signaler que l’information n’est pas sûre (marque de probabilité) ; ajouter une appréciation positive ou négative. Les procédés de modalisation sont nombreux : l’intonation (à l’oral), la typographie, la ponctuation (à l’écrit), certains types de phrase, des verbes d’opinion et de jugement, certains adverbes (peut-être, sans doute), certaines figures de style (ironie).
La prise de distance de l’émetteur vis-à-vis de son énoncé peut se faire avec le conditionnel, ou par des phrases qui citent plus ou moins précisément les sources de l’information.
Leçon publiée dans Grammaire et expression 3e Nathan
***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Fiche 29 : Le discours rapporté 1
Discours direct, discours indirect
Observation
La terrine de poulet
En 1870, sous l’occupation prussienne, la diligence Rouen-Dieppe emporte des « gredins honnêtes » et Boule de Suif, une prostituée qu’ils méprisent.
Mais Loiseau dévorait des yeux la terrine de poulet. Il dit :
« À la bonne heure, madame a eu plus de précaution que nous. Il y a des personnes qui savent toujours penser à tout. » Elle leva la tête vers lui : « Si vous en désirez, monsieur ? C’est dur de jeûner depuis le matin. » Il salua : « Ma foi, franchement, je ne refuse pas, je n’en peux plus. À la guerre comme à la guerre, n’est-ce pas, madame ? » Et, jetant un regard circulaire, il ajouta : « Dans des moments comme celui-ci, on est bien aise de trouver des gens qui vous obligent. » Il avait un journal, qu’il étendit pour ne point tacher son pantalon, et sur la pointe d’un couteau toujours logé dans sa poche, il enleva une cuisse toute vernie de gelée, la dépeça des dents, puis la mâcha avec une satisfaction si évidente qu’il y eut dans la voiture un grand soupir de détresse.
Mais Boule de Suif, d’une voix humble et douce, proposa aux bonnes sœurs de partager sa collation. Ellesacceptèrent toutes les deux instantanément et, sans lever les yeux, se mirent à manger très vite après avoir balbutié des remerciements. Cornudet ne refusa pas non plus les offres de sa voisine, et l’on forma avec les religieuses une sorte de table en développant des journaux sur les genoux.
Les bouches s’ouvraient et se fermaient sans cesse, avalaient, mastiquaient, engloutissaient férocement. Loiseau, dans son coin, travaillait dur et, à voix basse, il engageait sa femme à l’imiter. Elle résista longtemps, puis, après une crispation qui lui parcourut les entrailles, elle céda. Alors son mari, arrondissant sa phrase, demanda à leur « charmante compagne » si elle lui permettait d’offrir un petit morceau à Mme Loiseau. Elle dit : « Mais oui, certainement, monsieur », avec un sourire aimable, et tendit la terrine.
Guy de Maupassant, Boule de Suif
Questions
1. Le narrateur est-il présent grammaticalement dans le texte ?
2. Quels personnages sont en présence ? Lesquels dialoguent ?
3. Comment le narrateur rapporte-t-il les paroles échangées par les personnages dans le premier paragraphe ? Quels verbes introduisent les paroles ? Quelle ponctuation est employée ?
4. Quelle conversation s’établit dans le second paragraphe ? Comment les paroles échangées sont-elles rapportées ? Quels verbes introduisent les paroles ?
5. Quels verbes résument des paroles ?
6. Reconstituez les paroles qui ont pu être prononcées à la place des groupes de mots en bleu. Donnez plusieurs possibilités.
Leçon
1. Le discours rapporté : deux situations de communication distinctes
• Tout récit, réel ou de fiction, est produit dans une situation de communication qui met en jeu un émetteur E, (ou narrateur), et un récepteur R (narrataire ou lecteur) :
• Dans un récit, des phrases exprimant des paroles ou des pensées de personnages peuvent être insérées dans la narration de base. On parle alors de discours rapporté.
Ce type de message fait état de deux situations de communication distinctes :
E > R : discours premier
e > r : discours inséré (rapporté).
Il y a donc :
— deux émetteurs, celui qui a prononcé les paroles (émetteur e), et celui qui les rapporte (l’émetteur ou narrateur E) ;
— deux récepteurs : celui à qui sont destinées les paroles rapportées (récepteur r) et celui à qui l’émetteur ou narrateur E s’adresse (récepteur R) ;
— deux situations d’espace et de temps : le lieu et le moment où les paroles ont été prononcées, et le lieu et le moment de la narration :
Ex. : La diligence Rouen-Dieppe en 1870, là où le dialogue a été échangé
Le lieu et le moment de l’écriture, quand le narrateur s’adresse au narrataire ou au lecteur
2. Définitions
Lorsque, dans un récit, le narrateur veut reproduire les paroles prononcées par des interlocuteurs, il devra choisir entre différentes représentations du discours de ses personnages :
— soit qu’il rapporte les paroles comme si les interlocuteurs étaient présents, en insérant les paroles rapportées dans la première situation de communication : ici, maintenant ; les paroles rapportées semblent être des paroles réelle = discours direct.
Ex. : Elle leva la tête vers lui : « Si vous en désirez, monsieur ? C’est dur de jeûner depuis le matin. »
— soit qu’il transpose les paroles en les enchâssant dans son récit ; les paroles ainsi rapportées sont adaptées pour s’insérer dans le récit = discours indirect.
Ex. : Son mari, demanda à leur charmante compagne si elle lui permettait d’offrir un petit morceau à Mme Loiseau.
3. Le discours rapporté : le discours direct
• l’émetteur
Le discours direct permet de rapporter, dans un récit, les paroles prononcées par un émetteur, telles qu’elles ont été (ou auraient pu) être prononcées. L’émetteur de ces paroles peut être distinct du narrateur du récit.
Ex. : Il ajouta : « Dans des moments comme celui-ci, on est bien aise de trouver des gens qui vous obligent. »
Dans un récit à la première personne, le narrateur peut se mettre en scène directement en rapportant ses propres paroles : le récit et le discours rapporté ont alors le même émetteur.
Ex. : Alors j’ai dit à Daniel : « La saison de chasse est terminée, il est inutile d’aller manifester ».
• Procédés grammaticaux
Les paroles rapportées au discours direct possèdent plusieurs caractéristiques :
— ce sont une ou plusieurs phrases grammaticalement indépendantes de l’ensemble du récit, sans marque de subordination
Ex. : Il salua : « Ma foi, je ne refuse pas, je n’en peux plus ».
— les pronoms personnels et les possessifs se rapportent aux interlocuteurs du discours direct; les marques d’énonciation appartiennent au système du discours : je-tu, ici, maintenant,…
[Loiseau] dit : « Madame a eu plus de précaution que nous. […] Ma foi, franchement, je ne refuse pas, je n’en peux plus. »
Je = Loiseau ; Madame = Boule de Suif
— les temps de conjugaison situent l’énoncé par rapport au moment de l’énonciation rapportée.
récit : passé simple
discours direct : présent de l’indicatif
— un verbe introducteur déclaratif : dire, crier, s’exclamer,… indique généralement le discours direct. Ce verbe peut se situer avant ou après le passage en discours direct, il peut être inséré sous forme de phrase incise, avec inversion du sujet (dit-elle) ; il peut également être implicite : « Elle leva la tête vers lui »
• Signes de ponctuation
À l’écrit, le discours rapporté se caractérise par :
— deux points (: ) qui précèdent les paroles rapportées,
— des guillemets : «… » qui les encadrent,
— un tiret (— ) marque le changement d’émetteur dans un dialogue, avec un passage à la ligne.
— dans les journaux, une mise en italiques.
• Contenu du discours direct
Le discours direct peut contenir toutes sortes d’énoncés : des actes de langage («Je te promets »), des ordres («Reviens vite »), des questions : « Puis-je offrir un morceau à Mme Loiseau ? », des interjections, des phrases incomplètes, incorrectes, des phrases en langue étrangère, des mots d’argot, de patois, des prononciations particulières.
Rapporter un discours direct est une sorte d’opération de citation.
Les paroles citées peuvent être transcrites telles que le narrateur les a entendues, ou plus ou moins reconstituées, sans qu’il soit possible au lecteur de le savoir de façon certaine.
3. Le discours transposé
Le discours indirect
Dans un récit, le discours indirect permet au narrateur de transposer, les paroles émises par un personnage en les intégrant à la narration.
Il y a également :
— deux émetteurs, celui qui a prononcé les paroles (émetteur e), et celui qui les rapporte (le narrateur ou l’émetteur E) ;
— deux récepteurs : celui à qui sont destinées les paroles (récepteur r) et celui à qui le narrateur s’adresse (récepteur R ou lecteur, auditeur) ;
— deux situations d’espace et de temps : le lieu et le moment où les paroles ont été prononcées, et le lieu et le moment de la narration :
Ex. : La diligence Rouen-Dieppe en 1870, où le dialogue a été échangé
Le lieu et le moment de l’écriture où le narrateur s’adresse au narrataire ou au lecteur
• l’émetteur
La seconde situation de communication n’est qu’évoquée : toutes ses marques (personnages, lieu, temps) sont traduites selon les repères de la narration et se rapportent aux mêmes personnes E et R tout au long de passage :
Ex. : Elle leva la tête vers lui et lui demanda s’il voulait partager son repas car elle se rendait compte qu’il était dur de jeûner depuis le début du voyage.
• Procédés grammaticaux
Les paroles transposées en discours indirect sont :
— présentées dans une subordonnée complément du verbe introduite par la conjonction de subordination que, et des mots interrogatifs comme si, comment, quand, qui, où.
Ex. : L’homme a demandé à la jeune femme où elle allait.
— présentées dans un groupe infinitif introduit par de
Ex. La jeune femme a promis aux passagers de partager toutes ses provisions.
• verbe introducteur
Le verbe introducteur renseigne sur l’acte de langage qui est mis en œuvre dans le discours indirect, ainsi que sur le ton des paroles prononcées. Il peut être :
• un verbe déclaratif : dire, expliquer, raconter, affirmer,…
• un verbe d’interrogation : demander…
• un verbe indiquant un ordre : ordonner, prier…
• contenu du discours transposé
Le discours indirect ne peut pas contenir les mêmes variétés d’énoncé que le discours direct. Il ne peut contenir ni questions directes, ni ordres, ni exclamations, ni phrases incomplètes ou incorrectes. Les paroles sont reformulées en fonction de la situation en cours.
• Passage du discours direct au discours indirect
Le passage du discours direct au discours indirect peut se faire quand on résume un texte, ou quand l’émetteur E assume la responsabilité des paroles prononcées. Il faut opérer une véritable traduction :
— les pronoms personnels et les déterminants possessifs passent généralement de la première et deuxième personnes (je-tu) à la troisième personne (il) sauf s’il y a identité entre l’émetteur rapporte des paroles qui le concernent lui-même ou concernent le groupe dont il fait partie :
Ex. : Elle a proposé : « Nous mangerons cette terrine de poulet »/ Elle a proposé qu’ils mangent…
mais aussi :
Ex. : Elle a proposé : « Nous irons au cinéma ce soir »/ elle a proposé que nous allions au cinéma ce soir-là.
On garde la 2e personne si le narrateur rapporte des paroles qui concernent celui ou ceux à qui il les rapporte :
Ex. : Elle a proposé que vous alliez au cinéma.
— le mot mis en apostrophe au discours direct est transposé et devient complément du verbe déclaratif :
Ex. : Boule de Suif, d’une voix humble et douce, proposa aux bonnes sœurs de partager sa collation.
— les marqueurs de lieu et de temps : ce jour-là, la veille,… là-bas,… remplacent les marques d’énonciation de discours : ici, maintenant, hier.
— pour exprimer un ordre, le mode impératif est remplacé par le subjonctif, ou plus souvent par l’infinitif ; les autres modes ne subissent pas de changement.
Ex.: Dis-lui de venir.
— les temps de conjugaison s’accordent à ceux des phrases enchâssantes :
• si le discours enchâssant est au présent ou au futur, aucun changement n’a lieu quant à l’emploi des temps :
• si le discours enchâssant est au passé, le discours indirect emploie, conformément à la concordance des temps :
— l’imparfait pour marquer la simultanéité
— le conditionnel présent ou passé pour marquer la postériorité
— le plus-que-parfait pour marquer l’antériorité :
Pour l’expression écrite
Pour attribuer à quelqu’un des paroles dont on lui laisse la responsabilité, plusieurs moyens s’offrent au narrateur :
1. citer les paroles au discours direct, avec des guillemets :
Ex. : Le P.D.G. a déclaré : « Nous réduisons les salaires de 5 % pour passer aux 35 heures hebdomadaires ».
2. utiliser, autant au discours direct qu’au discours indirect , un verbe introducteur qui marque la distance ou tout autre modalisation
Ex. : soutenir, prétendre, alléguer, avancer, prétexter, revendiquer, arguer, etc.
Résumé :
On appelle discours rapporté l’insertion, dans un texte, d’énoncés qui proviennent d’une autre situation de communication. Deux situations de communication sont ainsi mises en rapport :
— la situation en cours, qui est celle du texte de base : émetteur E, récepteur R ;
— la situation rapportée, qui est celle de l’énoncé rapporté: émetteur e, récepteur r.
Le discours rapporté direct permet de citer un message relevant d’une autre situation de communication, ou du moins de le présenter comme une citation. Le message est présenté avec une ponctuation spécifique. Il contient des pronoms, des marques d’énonciation qui correspondent à sa propre situation d’énonciation.
Le discours rapporté indirect oblige à reformuler l’énoncé rapporté. Les paroles rapportées sont introduites par un mot subordonnant qui les relie au verbe principal. Les pronoms personnels et les marques d’énonciation sont ceux de l’ensemble du texte de base.
Leçon publiée dans Grammaire et expression 3e Nathan
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Fiche 30 Le discours rapporté (2)
Le discours indirect libre
Le discours raconté
La citation
Observation
Soir de débauche
Chez les marchands de vin, des pochards s’installaient déjà, gueulant et gesticulant. Et un bruit du tonnerre de Dieu montait des voix glapissantes, des voix grasses, au milieu du continuel roulement des pieds sur le trottoir. « Dis donc ! viens-tu becqueter ?…. Arrive, clampin ! je paie un canon de la bouteille… Tiens ! v’la Pauline ! ah bien ! non, on va rien se tordre ! » Les portes battaient, lâchant des odeurs de vin et des bouffées de cornet à pistons. On faisait la queue devant l’Assommoir du père Colombe, allumé comme une cathédrale pour une grand-messe ; et, nom de Dieu ! on aurait dit une vraie cérémonie, car les bons zigs chantaient là-dedans avec des mines de chantres au lutrin, les joues enflées, le bedon arrondi. On célébrait la sainte-touche, quoi ! une sainte bien aimable, qui doit tenir la caisse au paradis. Seulement, à voir avec quel entrain ça débutait, les petits rentiers, promenant leurs épouses, répétaient en hochant la tête qu’il y aurait bigrement des hommes soûls dans Paris, cette nuit-là. Et la nuit était très sombre, morte et glacée, au-dessus de ce bousin, trouée uniquement par les lignes de feu des boulevards, aux quatre coins du ciel.
Plantée devant l’Assommoir, Gervaise songeait. Si elle avait eu deux sous, elle serait entrée boire la goutte. Peut-être qu’une goutte lui aurait coupé la faim. Ah ! elle en avait bu des gouttes ! Ça lui semblait bien bon tout de même. Et, de loin, elle contemplait la machine à soûler, en sentant que son malheur venait de là, et en faisant le rêve de s’achever avec de l’eau-de-vie, le jour où elle aurait de quoi. Mais un frisson lui passa dans les cheveux, elle vit que la nuit était noire. Allons, la bonne heure arrivait. C’était l’instant d’avoir du cœur et de se montrer gentille, si elle ne voulait pas crever au milieu de l’allégresse générale.
Émile Zola, L’Assommoir
Questions
1. Repérez les paroles citées directement. Qui les prononce ? Commentez le vocabulaire, la prononciation, le type des phrases employées.
2. Comment sont rapportées les paroles des petits rentiers ? Quel jugement traduisent-elles ?
3. Mettez les passages en bleu au discours indirect en inventant une expression introductrice : qui parle ? Quels changements apportez-vous dans le vocabulaire ? Les phrases obtenues gardent-elles la spontanéité du texte original ?
4. Transposez les groupes en rouge au discours direct en faisant parler le personnage, puis au discours indirect. laquelle des trois formules est la mieux adaptée pour restituer le rythme de la pensée de l’héroïne ?
Leçon
1. Le discours rapporté libre
• Définition
Dans un texte, des paroles peuvent être insérées sans marque explicite : il n’y a ni verbe introducteur, ni ponctuation particulière.
C’est au lecteur de repérer la trace de paroles prononcées et de les attribuer à tel ou tel personnage.
On appelle discours rapporté libre cette manière d’insérer des paroles dans un texte sans marque explicite. Les paroles sont presque totalement intégrées au contexte narratif.
• Procédés grammaticaux
Les paroles transposées en discours indirect libre sont présentées dans une phrase juxtaposée à la phrase de récit qui la précède signalée entre […], sans marque de subordination, sans verbe déclaratif :
Ex. : [On faisait la queue devant l’Assommoir du père Colombe, allumé comme une cathédrale pour une grand-messe] ; et, nom de Dieu ! on aurait dit une vraie cérémonie.
Les paroles citées contiennent souvent un vocabulaire propre au personnage et non au narrateur :
Ex. : Si elle avait eu deux sous, elle serait entrée boire la goutte.
Les pronoms personnels, les possessifs et les marqueurs spatio-temporels appartiennent au système du récit dans le discours indirect libre :
Ex. : Les Grégoire chargeaient Cécile de leurs aumônes. Cela rentrait dans leur idée d’une belle éducation. Il fallait être charitable,ils disaient eux-mêmes que leur maison était la maison du Bon Dieu. Du reste, ils se flattaient de faire la charité avec intelligence, travaillés de la continuelle crainte d’être trompés et d’encourager le vice. Ainsi, ils ne donnaient jamais d’argent, jamais ! pas dix sous, pas deux sous, car c’était un fait connu, dès qu’un pauvre avait deux sous, il les buvait. Leurs aumônes étaient donc toujours en nature.
Émile Zola, Germinal.
Remarque
Quand les pronoms personnels et les autres marques d’énonciation appartiennent au système du discours, les paroles rapportées sont au discours direct libre :
Ex. : À Champagne sur Seine, où il s’est arrêté pour embrasser les enfants, Alice l’attendait. Elle le trouve vif, alerte, s’en réjouit, le questionne, quel bon vent t’amène mon amour. Je n’ai pas le temps, je descends à Lyon, j’ai du travail. À l’usine. Oui et non, je t’expliquerai plus tard, occupe-toi des enfants, profitez des vacances. Mais où vas-tu t’abriter, et les communistes ? Ne t’inquiète pas, tout s’arrangera bientôt. Il lui montre sa carte d’adhérent au PPF en riant, il exulte, il est heureux.
Marie Chaix, Les lauriers du lac de Constance, ©Seuil, 1974.
Les temps de conjugaison suivent la concordance des temps (voir leçon 9). Le mode indicatif, qui ne peut être maintenu, se transpose au subjonctif présent :
Ex. : Il se pencha vers moi. Avais-je une cartouche de stylo de rechange ? Que je la lui passe.
• Contenu des paroles rapportées
Le discours indirect libre offre des possibilités d’expression plus riches que le discours indirect.
Il peut comporter tous les éléments qui caractérisent le discours direct :
— des apostrophes :
Ex. : Elle la prit sur ses genoux. Mademoiselle n’était pas sage, quoi qu’elle eût sept ans bientôt.
Gustave Flaubert, L’Education sentimentale.
— des exclamations, des interrogations :
Ex. : Peut-être qu’une goutte lui aurait coupé la faim ? Ah ! elle en avait bu des gouttes !
— des expressions familières, de l’argot, des mots étrangers, des marques d’accent, de patois :
Ex. : Ainsi, lui se faisait fort, s’il s’en occupait, d’amener la Compagnie à des conditions meilleures : au lieu que, va te faire fiche ! on y crèverait tous, en s’obstinant.
Émile Zola, Germinal.
• Effets de style
* Le discours indirect libre existe depuis le Moyen-Âge. Il est fréquemment présent dans les Fables de La Fontaine, et a été plus systématiquement utilisé dans la littérature romanesque du XIXe siècle. Il se rencontre également à l’oral.
C’est une forme très souple qui supprime les marques de subordination du discours indirect en évitant la répétition de que en cascade.
* Le discours indirect libre restitue la spontanéité du discours direct en permettant de reproduire différents registres de langue et toutes les formes de subjectivité, en atténuant la brutalité des paroles directes.
Il permet de reproduire les pensées d’un personnage par un monologue intérieur inséré dans le récit :
Ex.: Elle abandonna la musique. Pourquoi jouer ? Qui l’entendrait ? Puisqu’elle ne pourrait jamais, en robe de velours à manches courtes, sur un piano d’Erard, […] sentir, comme une brise, circuler autour d’elle un murmure d’extase, ce n’était point la peine de s’ennuyer à étudier.
Gustave Flaubert, Madame Bovary.
* Dans la presse écrite contemporaine, le discours indirect libre est fréquemment employé dans les faits divers. Il permet d’insérer la voix des acteurs ou des témoins dans le récit du journaliste :
Ex.: Interpellé, M. nie avoir agressé le chauffeur du bus. A l’heure de l’agression, il regardait la télévision chez ses voisins.
2. Le discours raconté
Le récit peut parfois rapporter des paroles échangées sans en donner le contenu exact, en les résumant. L’essentiel est traduit par un verbe qui implique une trace de parole, ou par un nom qui offre les mêmes caractéristiques :
Ex. : Le Président s’excusa, demanda pardon. L’homme nie. Il a fait une longue déclaration.
Cette forme est un discours raconté. Le narrateur ne garde que l’essentiel du message et l’intègre totalement dans le récit.
3. La citation
Certains textes portent la marque d’un mot ou d’une expression que l’émetteur ne veut pas reprendre à son compte, et dont il laisse la responsabilité à un autre émetteur, généralement désigné dans le texte :
Ex. : Aussitôt qu’elle fut reconnue, des chuchotements coururent parmi les femmes honnêtes, et les mots de « prostituée », de « honte publique » furent chuchotés si haut qu’elle leva la tête.
Maupassant, Boule de suif
L’émetteur signale qu’il parle avec les mots d’un autre. C’est l’effet-guillemets, fréquent chez les journalistes, ou dans les rédactions de jeunes élèves qui veulent insérer un mot familier en prévenant que le lecteur ne doit pas le leur imputer.
Tableaux récapitulatifs
Pour l’expression écrite
La polyphonie
Le discours indirect libre permet des effets très subtils.
Dans le passage cité, Zola fait entendre trois voix de personnages : celle des ouvriers et celle de l’héroïne, marquées par l’emploi du vocabulaire populaire, est rapportée par le discours direct et le discours indirect libre. Leur vision de l’alcoolisme est (faussement) positive ; la voix des petits rentiers, rapportée au discours indirect, désapprouve, au contraire, la débauche.
Enfin, la voix du narrateur se mêle à celle des personnages dans les passages de récit. C’est lui qui compare l’Assommoir à une église : « allumé comme une cathédrale pour une grand-messe ». Le narrateur semble avoir ici une certaine sympathie pour Gervaise et les ouvriers.
Mais il emploie également, pour les désigner, un vocabulaire péjoratif : « des pochards, gueulant et gesticulant ». Dans ce dernier cas, la voix du narrateur se rapproche de celle des bourgeois qui critiquent les ouvriers. Les différents discours marquent l’ambivalence du narrateur par rapport à ses personnages.
Résumé
Le discours rapporté libre permet d’insérer des paroles dans un texte sans marque explicite : ni verbe introducteur, ni ponctuation particulière. Les marques de temps et de personnes sont unifiées sur celles du texte de base, comme dans le discours indirect.
Le discours indirect libre peut contenir des éléments subjectifs : des interjections, des apostrophes, des phrases interrogatives ou exclamatives, des expressions familières, comme le discours direct.
Le discours raconté réduit les paroles rapportées à leur contenu afin de les intégrer totalement au récit.
La citation entre guillemets permet à l’émetteur de prendre distance avec un mot ou une expression dont il laisse la responsabilité à quelqu’un d’autre.
Leçon publiée dans Grammaire et expression 3e Nathan
**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
fin
la lecture analytique
Méthodologie: lecture analytique
Fiche méthodologique : la lecture analytique
Définition de l'exercice :
La lecture analytique est l'étude et l'explication organisée d'un texte littéraire. L'adjectif « organisée » suppose que l'interprétation du texte, l'explication consiste en un exposé clair comprenant une introduction, un développement en plusieurs parties reliées entre elles par des transitions et une conclusion.
Objectifs et enjeux :
Il s'agit de dégager la spécificité et les enjeux du texte, son originalité (originalité qui peut se réaliser dans la forme, dans le sujet, dans la façon de le traiter ou encore dans l'intention de l'auteur).
Le travail préparatoire :
Après avoir lu le texte plusieurs fois, il s'agit de dégager ses premières impressions mais aussi d'interroger le texte. Questions à se poser : nature du texte ? Situation du texte ? Idée générale du texte ? Quelle est la composition du texte (son mouvement, sa structure). Situation d'énonciation ? Enjeux du texte, objectif de l'auteur. Il est nécessaire ensuite de procéder à une analyse linéaire du texte. On peut s'appuyer sur les champs lexicaux, les figures de style, l'ensemble des procédés littéraires et des faits textuels. Attention ! Repérer un fait textuel ne suffit pas, il faut impérativement l'analyser et en tirer une interprétation. Il doit vous permettre d'éclairer le sens du texte. C'est cette 1èreapproche analytique du texte qui vous permettra de dégager une problématique. A l'oral la problématique = la question donnée par l'examinateur !
La mise en œuvre :
1 - l'introduction :
Après une première phrase d'amorce (une phrase d'ouverture inspirée par la situation, la nature du texte ou le thème abordé), elle s'organise en 3 temps :
- situer le texte : nom de l'auteur/ situation du texte dans l'œuvre de l'auteur (Titre notamment)/ situation dans le contexte
- présentation rapide de l'extrait (genre du texte, type de texte, ton, registre)
- idée générale du texte, données nécessaires à sa compréhension
2 - la lecture du texte : cette étape est importante dans la mesure où elle doit capter l'attention de votre auditoire (et celle du jury). Elle doit être expressive et témoigner de votre compréhension du texte (diction claire, intonation). Il s'agit véritablement de mettre le texte en voix.
3 - La problématique et l'annonce du plan :
Lors des épreuves orales, votre problématique réside dans la question que l'examinateur vous a proposée. Vous devez la rappeler et annoncer les axes qui vont structurer votre développement (= votre plan).
4 - Le développement :
Le développement consiste en l'exposé de chaque axe de lecture et s'appuie sur le relevé des indices du texte qui viennent illustrer et justifier vos affirmations (penser à indiquer les lignes et à étayer vos propos de citations). Chaque axe de lecture doit être rapidement introduit ; il convient également de proposer une conclusion partielle à la fin de chaque partie. Vous devez ménager les transitions d'un axe à l'autre.
5 - La conclusion :
- Il s'agit de proposer un récapitulatif de vos conclusions partielles en essayant de varier la formulation pour éviter les répétitions.
- Vous apportez une réponse à la question soulevée par la problématique
- Vous ouvrez ou élargissez en situant le passage dans son objet d'étude, l'œuvre ou un courant littéraire